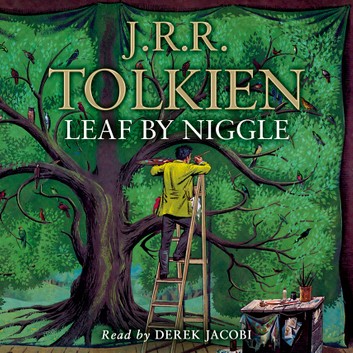Par Christian Chelebourg, Université de Lorraine, courtesy The Conversation
Quels points communs entre Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, et Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney ? Aucun, sinon que les deux œuvres à destination du jeune public ont vu le jour à quelques mois d’intervalle – le roman en septembre 1937, le dessin animé à Noël – et qu’elles mettent toutes deux en scène un groupe de Nains.
Tolkien a découvert ceux de Disney au début de 1939, dans un cinéma où l’avait malicieusement entraîné son collègue et ami C.S. Lewis, le futur auteur des Chroniques de Narnia, qui avait précédemment vu le film avec son frère. Les deux austères professeurs de l’Université d’Oxford en sont sortis révoltés. La réaction du père de Bilbo face à Prof, Dormeur, Grincheux ou Simplet est le symptôme d’un clivage culturel qui se mettait alors en place dans les fictions de jeunesse et reste encore bien vivace.
Dans ces années 1930 qui voient éclore la culture de masse sur les ruines de la culture populaire, Disney et Tolkien représentent deux manières antagonistes de revivifier le vieux fonds folklorique.
Les humanités contre le spectacle
Pour Tolkien, spécialiste de vieil anglais et de philologie scandinave, le merveilleux est une affaire sérieuse qui touche au sacré par le truchement du mythe. Avant même de concevoir Le Hobbit pour son fils Christopher, il vient à l’invention littéraire pour prolonger le plaisir intellectuel de ses études.
C’est ainsi qu’il crée diverses langues imaginaires ainsi que Le Silmarillion, un ensemble de légendes qui s’ouvre sur une cosmogonie musicale et retrace les premiers âges de son univers imaginaire, la Terre du Milieu. À l’intention des jeunes lecteurs, Le Hobbit transfère cette veine poétique sur le terrain de l’aventure, sans transiger sur sa dimension démiurgique.
Pour Walt Disney, les contes de fées sont avant tout un divertissement, et même un spectacle. On sait qu’il s’est déterminé à produire Blanche-Neige en souvenir du plaisir qu’il avait eu, enfant, à en voir l’adaptation cinématographique que Winthrop Ames, alias Jessie Braham White, avait tirée de sa pièce en 1916. C’est à cet ancien directeur du Little Theatre de Broadway que l’on doit les accents shakespeariens du dessin animé.
Disney s’est adonné très tôt au merveilleux. Dès 1922, il transpose dans l’Amérique d’alors « Le Petit Chaperon rouge », « Le Chat botté » ou encore « Cendrillon » ; autant de cartoon shorts qui enchaînent les gags sur le modèle du cinéma muet. À partir de 1929, avec les « Silly Symphonies », il met au point l’esthétique qu’on lui connaît en poussant ses équipes à s’inspirer des grands illustrateurs européens – Gustave Doré, Honoré Daumier, Beatrix Potter, etc. – aussi bien que des peintres préraphaélites et de l’expressionnisme allemand. L’humour reste présent, mais la poésie et l’ambition artistique s’y ajoutent.
Mais le résultat de cette curieuse alchimie graphique n’inspire à Tolkien qu’un « dégoût sincère ». Dès 1937, il s’insurge contre toute idée d’une illustration américaine du Hobbit dans le style Disney. En sortant de Blanche-Neige, C.S. Lewis n’hésite pas, de son côté, à traiter Walt Disney de « pauvre nigaud« . Reconnaissant tout de même un certain mérite aux scènes terrifiantes du film, il ajoute : « Qu’est-ce que cela aurait pu être si cet homme avait été éduqué – ou même s’il avait grandi dans une société convenable ? » Une lettre adressée par Tolkien en 1964 à un correspondant non identifié le montre sur la même longueur d’onde :
« Je reconnais son talent, mais il m’a toujours semblé désespérément dévoyé [corrupted]. Bien que dans la plupart des « films » produits par ses studios il y ait des passages admirables ou charmants, l’effet de chacun d’entre eux est pour moi le dégoût. Certains m’ont donné la nausée…«
La révulsion de 1937 face aux « Silly Symphonies » se voit expliquée par un traitement indigne de la féerie, autrement dit une trahison de son essence. La cause est entendue : aux yeux des deux plus célèbres membres du cercle littéraire des « Inklings » d’Oxford, Walt Disney est avant tout un Yankee inculte et grossier.
Au lieu d’être interprétés comme le résultat de choix mûrement réfléchis, ses succès sont attribués à un manque de compétence voire d’intelligence, en tout cas de connaissances et de réflexion. Tolkien et C.S. Lewis se posent en défenseurs de l’art contre une entreprise essentiellement commerciale, ainsi que le suggère en anglais l’emploi de « corrupted ».
Deux conceptions de l’enfance
D’un côté, on aurait donc l’Art – celui auquel on met un grand A –, reconnaissable à sa fidélité à une tradition académique ; de l’autre une industrie culturelle sans vergogne, qui formaterait sa marchandise pour qu’elle soit immédiatement accessible au plus grand nombre. D’un côté le raffinement, de l’autre la vulgarité. Ce préjugé détermine encore, de nos jours, la mauvaise réputation dont Disney pâtit dans les milieux éducatifs.
Le jugement de Tolkien correspond à une conception toujours dominante de la littérature de jeunesse comme voie d’accès à la culture légitime. On se rappelle les documents d’application des programmes de littérature pour le cycle 3, évoquant un corpus qui « fait la courte échelle aux plus jeunes pour les introduire à l’univers infini des lectures à venir« .
Disney, en revanche, s’adresse à l’enfant pour lui-même. Il est à l’avant-garde du mouvement qui allait engendrer, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une culture jeune indépendante de celle des adultes, et affranchie de toute préoccupation pédagogique. Avant la naissance de Superman en juin 1938 et celle de Batman en mai 39, la sortie de Blanche-Neige marque le coup d’envoi d’un phénomène que la géopolitique allait enrayer : l’avènement des fictions récréatives.
Pour Tolkien comme pour Lewis, l’enfant est un adulte en devenir ; pour Disney, c’est un individu à part entière. Quand Tolkien et Lewis s’adressent à leurs lecteurs sur le mode édificateur de l’allégorie – même si le second s’en défend –, Disney ne prétend rien offrir d’autre à ses spectateurs qu’un antidote à la brutalité du monde. Pour les uns, la féerie est une fin en soi ; pour l’autre c’est un moyen, au même titre que l’aventure, le western ou la science-fiction.
Dans Feuille, de Niggle, une nouvelle sans doute écrite en 1942 mais datée par Tolkien de 1938-39 et publiée en 1945, le romancier raconte l’histoire d’un peintre amateur qui donne vie à un arbre avant de partir se retirer dans le paysage né de son tableau. Tom Shippey, l’un des meilleurs spécialistes britanniques de Tolkien, a dégagé la portée autobiographique du récit. Tolkien y transcrit son travail tatillon – niggle en anglais – sur le texte.
Disney est tout aussi méticuleux, mais il se soucie moins d’imiter ou de pasticher l’héritage féerique, disons de se greffer sur lui, que de le régénérer à l’intention des enfants de son temps. L’esthétique cartoonesque qui rebute tant les deux « Inklings » procède de cette modernisation d’un héritage qu’il estime être celui des enfants, non des élites savantes.
Restauration ou réhabilitation
Le procès que Tolkien et Lewis intentent à Walt Disney anticipe les débats sur la submersion de la culture populaire anglaise par la culture de masse américaine qui allaient conduire à la création, en 1964, du Center for Contemporary Cultural Studies de l’Université de Birmingham.
Tolkien et C.S. Lewis, aussi bien que Walt Disney, travaillent à sauver la matière féerique du naufrage. Mais les premiers, tous deux médiévistes, ne conçoivent d’y parvenir qu’en entretenant un lien solide avec l’histoire du genre. Walt Disney, quant à lui, n’hésite pas à bousculer les codes anciens. Au demeurant, ses références, ses modèles, ne remontent guère qu’au XIX° siècle. Le seul art qui vaille à ses yeux, c’est celui du conteur qui captive son auditoire. On sait d’ailleurs que, dans la phase de préparation de Blanche-Neige, il excellait à incarner chacun des nains. Il y a du saltimbanque en lui, autant qu’il reste de professeur chez Tolkien. Si l’on peut parler de l’esprit des contes de fées en termes de conservation du patrimoine, disons que Tolkien travaille à le restaurer tandis que Disney le réhabilite.
Ce qui entretient le prestige de Tolkien auprès des enseignants, c’est qu’il écrit presque autant pour ses pairs que pour la jeunesse. Disney reste cantonné aux cours de récréation. Il ne faut pourtant pas s’y tromper, c’est chez lui qu’on pourrait le mieux appréhender ce que signifie créer pour l’enfance et la jeunesse.
Aujourd’hui, Tolkien est un auteur « mainstream », après avoir été longtemps l’apanage des hippies et des rôlistes. Cette notoriété que lui ont acquise les films de Peter Jackson, il a bien failli la devoir à la Walt Disney Company par l’entremise de Miramax. Si le PDG de Disney, Michael Eisner, n’avait pas refusé l’allonge budgétaire nécessaire à sa filiale pour produire Le Seigneur des Anneaux, c’est sous son label que le film serait sorti. New Line a empoché la mise pour Time Warner, mais non sans assurer à son concurrent 5 % des revenus bruts de la trilogie.
C.S. Lewis n’a pas eu autant de chance, puisque les deux premiers volets des Chroniques de Narnia ont été produits par Walt Disney Pictures et le troisième par 20th Century Fox, désormais propriété de Disney. La culture de masse est un sport arbitré par le public et, à la fin, c’est Mickey qui gagne.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.