Fondée en 2010, la revue Hey ! Modern art and pop culture est un acteur incontournable des arts graphiques contemporains. Peinture, dessin, sculpture : tous les formats sont explorés, numéro après numéro par le duo Anne et Julien qui défriche la culture pop consciencieusement depuis près de 30 ans. Souvent dérangeantes, toujours étonnantes, les œuvres repérées par la team Hey ! résonnent avec notre époque exubérante, angoissée et optimiste -en un mot, fiévreuse.
Nous avons profité de leur récente exposition à la hautement recommandable galerie parisienne Arts Factory pour discuter en longueur avec l’une des deux têtes de Hey !, Anne. Vive, courageuse, passionnée, elle brosse pour Postapmag l’histoire des dernières décennies par le prisme de ce qui, sous le radar souvent défaillant des médias, a fait battre le cœur des esthètes, des dandys, des rêveurs, des artistes, bref de tous ces hommes et femmes qui donnent à leurs semblables de vraies bonnes raisons de se lever le matin. Free parties, Free Press, Internet, Punk et révolutions graphiques : rien n’échappe à Anne et Julien, dont l’exposition « Tatoueurs, Tatoués » avait attiré plus de 700 000 visiteurs au Musée du Quai-Branly en 2015. Quand le monde bouge, Anne et Julien ne sont pas loin. Par conséquent, soyez sur vos gardes : En compagnie de Hey !, vous vous engagez dans un périple dont les paysages sont de cauchemars et de rêves.





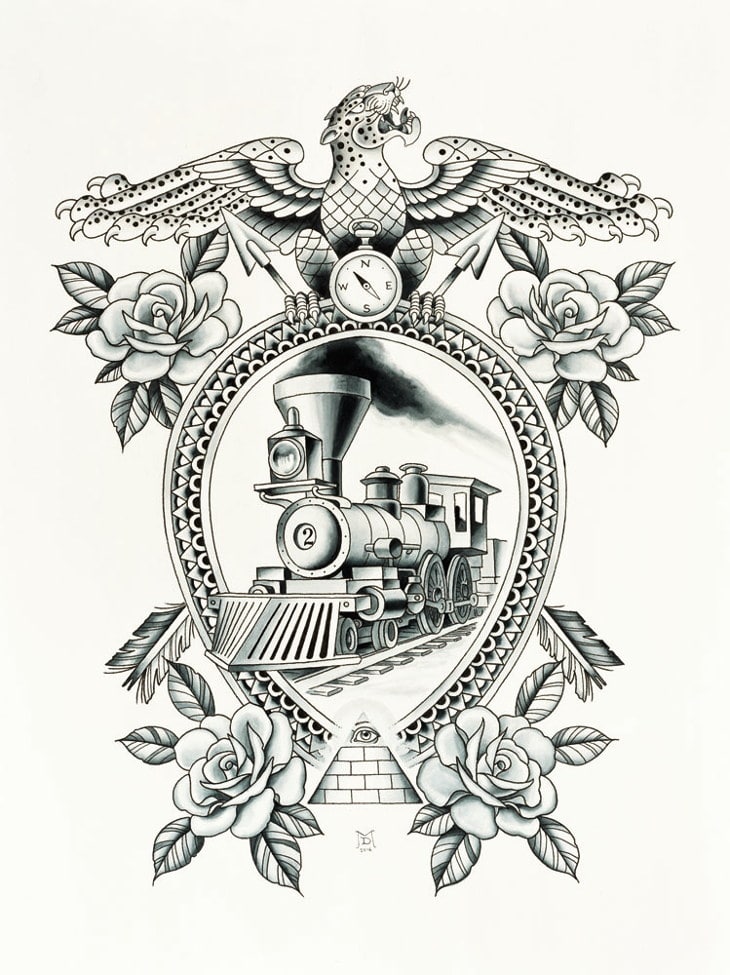




Aux origines de Hey ! : l’héritage de la free press
PostAp Mag. Comment vous présenter, en quelques mots ?
Anne (Hey !). Avec Julien, nous nous sommes spécialisés dans l’évocation des cultures alternatives depuis 1986 : dès cette époque, quel que soit le média qui s’intéressait au sujet, ou que l’on pouvait utiliser, on diffusait cette philosophie-là, ou ces philosophies. On a fait de la programmation de films, monté des festivals, organisé des spectacles de rue, on est devenus journalistes, on a écrit des livres, on a signé des documentaires et on a ouvert une galerie d’art en 1990, tout ça pour raconter toujours la même chose, c’est-à-dire délivrer un commentaire amoureux sur les contre-cultures, le message qu’elles portent et, surtout leur esthétique. Au fur et à mesure du temps, on s’est rendu compte que ce qui nous intéresse toujours plus, ce sont les langages, les vocabulaires artistiques.
Pourquoi avoir opté pour la création d’une revue ?
Il faut dire que la presse a beaucoup changé, au fil du temps. On a de vrais rédacteurs en chef et des vraies conférences de rédaction… Puis on a vu le territoire se réduire comme peau de chagrin. C’est un mouvement qui a commencé dans les maisons de disque, au tout début des années 1990, quand, peu à peu, les aficionados, ceux qui avaient vraiment la connaissance, et donc l’amour, et donc le pouvoir de porter des projets, étaient remplacés petit à petit par des jeunes gens sortis d’école de commerce. Le même phénomène s’est produit chez les éditeurs, spécifiquement de bande dessinée, et ça a été très très, très, très violent. Au fond, on est arrivé à un âge où l’on s’est dit qu’on en avait assez de subir les idées des autres. J’adorerais, j’adore travailler pour des titres et des rédacteurs en chef que j’admire, vraiment talentueux, qui me guident. C’est une démarche particulière, tu amènes un sujet qui n’est pas tout à fait fini ou un peu vert et, après simplement une discussion de couloir, tu repars avec une sensation nouvelle sur le sujet. C’est super d’être vraiment portée, par un esprit.
C’est pourquoi je dis que Hey ! est un projet profondément égoïste : on a décidé de ne défendre que notre propre vision du monde. La particularité du véritable contre-culturel, c’est de porter quelque chose d’intime, comme une vérité qui existe, pour ensuite lui donner corps, la faire exister. Au final, on a simplement appliqué ce en quoi l’on croyait depuis que l’on est préadolescents, nos propres obsessions.

C’est quoi un bon rédacteur en chef ? C’était qui ? Des noms !
Je vais citer Jean-François Bizot, parce que c’est quelqu’un qui mérite qu’on ne l’oublie absolument jamais, c’est un des génies de la presse contre-culturelle française. Il était habité par l’amour sincère de tout ce qu’il défendait, doublé d’une grande connaissance, par une curiosité intense et par le désir de changer le monde. Il a donc tout fait pour rendre tout cela visible, tangible. C’est ce qui a donné Actuel, qu’il a co-fondé, hein, parce qu’on croit souvent qu’il l’a fait tout seul, mais ça ne se fait jamais tout seul un truc pareil (Quelques grands noms de l’équipe Actuel ? Michel-Antoine Burnier, Frédéric Joignot, Claudine Maugendre, Patrick Rambaud, Jean-Pierre Lentin, Jean Rouzaud, Frémion, Patrice Van Eersel, Léon Mercadet, ndlr). Mais lui, il l’a porté, il était vraiment illuminé quoi, et il avait dix idées à la seconde. Il était tyrannique, il était génial, il menait la rédaction à la baguette et en même temps il laissait sa chance absolument à tout le monde. Vous pouviez arriver et avoir 16 ans, si vous avez l’once d’un minime talent, Jean-François savait le voir. Vous ne saviez pas écrire, vous ne saviez pas parler, mais si vous portiez une idée, si vous incarniez quelque chose, il vous prenait sous son aile.
C’était quelqu’un qui savait lire entre les lignes, qui s’intéressait profondément aux individus. S’intéresser au sujet, c’est s’intéresser aux individus, quoi qu’il arrive, quand on est dans le journalisme Gonzo. Or lui, c’est ce qu’il portait, c’était son école de journalisme, et c’est quelqu’un qui s’est épanoui à travers ce qui nous fait rêver en termes de période, c’est-à-dire la création de la critique rock, c’est-à-dire la création de la presse musicale, c’est-à-dire l’explosion de la Free Press.
J’ai rencontré une femme aussi, qui est très discrète et qui n’aime pas du tout qu’on parle d’elle, c’est quelqu’un qui s’appelle Florence Monteil, qui a créé le titre Muze. C’était le début des titres féminins pour jeunes filles et jeunes femmes, mais littéraire et avec du fond, il ne vend pas que de la sandale, des produits de beauté et de la petite culotte. Une très grande journaliste. Évidemment il y a Christophe Bourseiller, que j’ai aussi connu dans les grandes heures, de loin, parce que quand on est jeune et qu’on admire et qu’on est transi, on regarde de loin… Mais même en regardant de loin, je pense que, quand on choisit d’être journaliste on est vraiment une éponge en termes de nature, et je peux vraiment vivre quelqu’un, même de loin, et être imprégnée fort. Il faudrait citer aussi Averty, pour la radio. En termes de musique, de folie et d’inspiration au micro, vraiment quelqu’un de génial. Il y en a une tonne, hein…
Refermons cette parenthèse, maintenant qu’on a semé quelques petits cailloux pour les lecteurs. J’aimerais savoir comment vous avez grandi, dans quel cadre, vos premiers chocs esthétiques…
Je ne vais pas parler de ça, c’est une période dont je ne parle pas.
Pas du tout ?
Non.
Est-ce-que vous voulez dire pourquoi ?
Parce que je reste professionnelle.
D’accord. Et les premières rencontres d’artistes…
Dans le cadre privé, la seule chose que je dirais, c’est les Sex Pistols. À l’époque, en 1977.
Comme choc esthétique ?
La rencontre d’une énergie, surtout. Il y avait à l’époque très peu de photos, il fallait être sur place pour voir. Sinon, vous aviez des espèces d’échos, ou des ricochets. Mais c’était tellement puissant, en termes d’énergie, que le ricochet vous arrivait même si vous étiez à des milliers de kilomètres. Sinon, je citerais Moebius. Je l’ai connu presque intimement : dans le milieu des années 80, on a créé avec Julien son fan-club européen. Puis on a découvert le manga, grâce à lui et à Jodorowsky… C’est une scène que quasiment personne ne connaissait dans les années 1980 en Europe. Il y avait très peu de clubs, et ils étaient très fermés. Aujourd’hui on appelle cela des geeks, mais en fait c’était des fans, des amoureux. C’est comme ça qu’on est devenu les premiers défenseurs du manga en France.
On était trois ou quatre, c’est tout. On a projeté pour la première fois en France le film Akira au cinéma l’Escurial, à côté de l’école des Gobelins, en 1989. Ce qui nous a valu une volée de bois vert de toute la presse, qui est arrivée… On ne sait comment. Il y avait tous les Gobelins qui étaient là, tous les jeunes gens, c’était vraiment la fête, il y avait Jodorowsky et Moebius qui présentaient le film, et toute la presse dont on avait absolument, profondément, rien à foutre. On les avait tous laissés debout en fond de salle. Il faut dire que c’était plein à craquer, il y avait des gens par terre, des gens debout… Et toute la presse était toute serré, debout. Akira dure longtemps, plus de deux heures… Déjà qu’ils étaient horrifiés par le film, par son esthétique monumentale, c’était drôle.
Énergie pure
C’est une époque très marquée par le décalage entre les marges et la presse la plus installée… D’un côté, une véritable effusion culturelle, de l’autre un regard des plus méprisants sur la pop culture.
Nous, on se situait dans l’exact décalage de ce mouvement-là. On avait la connaissance du terrain, parce que c’était nos milieux à nous. C’était là où on passait notre temps, et on a toujours eu cette curiosité de l’autre. Or, on a toujours beaucoup parlé de nos expériences avec tous ceux qu’on rencontrait et à Paris, quand tu traînes un peu, tu rencontres très vite des gens qui savent écouter. Des gens comme Bizot, et beaucoup d’autres, ont vu qu’on avait des grosses connaissances de terrain, puisqu’on passait notre temps là-dedans. Alors, ils nous ont vu comme un joint entre des niches considérées comme impénétrables. On faisait en quelque sorte le « go-between » entre les gros médias nationaux et les marges.
Comment percevez-vous la culture, ou la contre-culture, de cette époque ? Le punk, comme les free-parties par exemple, c’est à la fois immensément libérateur… Et, il me semble, profondément désespéré.
La free party est née d’un fait, d’une chose factuelle, c’est l’édit de Thatcher qui a chassé les squatteurs de Londres. À Londres, il y avait toute une population qui avait vécu le punk de plein fouet. Et le punk n’a pas explosé en vol, contrairement aux Sex Pistols. Ceux qui vivaient le punk le vivaient comme une vision de la vie. Or à Londres, à cette époque-là, il y a énormément de bâtiments vides, du fait de la désindustrialisation, ce qui se conjugue alors à un autre mouvement très fort en Angleterre, les travellers. Ainsi qu’à une expérimentation musicale, avec la communauté jamaïcaine et le début du numérique. Dans les studios d’enregistrement, c’est vraiment le début de la bidouille digitale. Tout cela se rencontre. Visions du monde + techniques digitales, ça donne les raves.

Le tout dans une situation sociale, disons, difficile, qui a fait que les Anglais avaient vraiment besoin de se retrouver et de s’amuser. Et pour couronner le tout, une nouvelle drogue arrive et cimente tout ça. Entre les travellers, qui sont par définition sur la route et qui parcourent la Grande-Bretagne, et ceux qui habitent à Londres et qui font péter Londres, qui vivent sous les ponts et foutent vraiment la merde, Thatcher pète les plombs. Une loi est promulguée pour chasser les squatteurs… Et ils arrivent en France. Mais j’ai oublié la question.
Elle portait plus spécifiquement sur la perception de ce mouvement…
Cette dynamique-là, c’est toujours la fin d’un courant -un mouvement dans le sens littéral du terme, le fait même de bouger. Un mouvement, une reconstruction, sur la fin d’un monde. On a toujours quelque chose qui se rebâtit, surtout quand c’est sous-tendu par une vision du monde. C’est ce qui fait que la scène, même de niche, même si elle est habitée par très, très peu de gens, elle est extrêmement solide. Les mecs arrivent en France, ils ont l’expérience, ils ont déjà vécu trois mouvements musicaux énormes, ils ont vécu le début du digital, donc l’explosion des sound systems jamaïcains, à Londres ou ailleurs, le reggae, le ragga et le début du hip-hop, et en plus ils ont les expérimentations technologiques. Musicalement, c’est extrêmement fort.
Là-dessus se greffe, parce que c’est l’histoire de la musique, la façon de diffuser. Non seulement tu es dans une dynamique qui demande l’organisation de fêtes autonomes, donc tu es dans une indépendance, une proclamation de l’indépendance, mais en plus tu as un moyen de diffusion technique. T’as ton camion, et avec un camion, dedans tu peux fabriquer ta musique, tu peux fabriquer ta drogue, tu peux bouger. Alors, si en plus tu as l’expérience d’ouvrir des squats et de monter des fêtes… Tout ça pour dire que, pour moi, ce n’est pas du tout le désespoir qui caractérise cette période. Bien au contraire, c’est le début d’une nouvelle histoire, énorme, révolutionnaire, qui d’ailleurs est devenue mondiale.
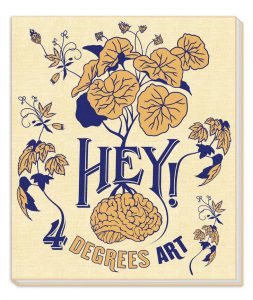
Changer le monde qui change
Vous avez parlé de vision du monde. Vous voulez dire, un projet politique ? Une vision de comment le monde doit être ? Ou quelque chose de plus littéralement esthétique , voire d’intime ? Ce qui pourrait nous amener à parler justement de peinture et de graphisme…
Une vision du monde, ce sont des gens qui, même sans le chercher, se dressent -sont obligés de se dresser- contre un système politique, puisque le système politique de la société dans laquelle ils sont nés les empêche de vivre tel qu’ils veulent vivre, là où ils veulent vivre. Ils ne veulent pas payer de loyer… Mais ils occupent des locaux qui sont tout pourris, désaffectés, c’est une logique. Puis des personnes le théorisent, comme Hakim Bey et son livre manifeste sur les Zones d’Autonomie Temporaires.
Donc tu as la théorie qui est là, qui est très forte, tu as l’artistique, en musique mais aussi en graphisme… Justement, ce qui a un peu été oublié, mais que nous, et tous les gens du tout début, ont vécu très fortement, c’est l’importance du graphisme dans cette histoire. Cette scène-là s’est développée à travers le flyer. Il n’y avait pas forcément de fanzine, à l’inverse du rock’n’roll ou avec le punk. Là, est resté le fly’. On n’avait pas de portable, on n’avait rien et il y avait ce petit bout de papier qui était vraiment crucial pour se donner des rencards. Le support papier est un support magnifique pour délivrer des messages, que ce soit des messages écrits ou dessinés. Il y a eu toute une esthétique très tôt mise en place par Mark Stormcore, le fondateur des Spiral Tribe : fond noir et graphisme blanc très simple et très signalétique.
Avant, l’esthétique des raves était très fluo, la free party s’est détachée de cela avec le noir et blanc. Le gros fantasme de cette époque-là, c’était la fractale, dans tous les sens, qui allait de pair avec la musique très métronomique, puis le VJing et son esthétique très typée. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c’est l’instinct qu’on en a au moment où on le vit, c’est-à-dire qu’au tout début, on s’échangeait tout. Il y avait aussi l’amour du sticker, mais le sticker coûtait cher, et il vient plutôt du hip-hop, mais il était présent dans la free party malgré tout. On a tous collectionné ça très tôt et très vite ! Comme pour les pochettes de disques, on a tous été très conscients tout de suite de la valeur esthétique des flyers.

Vous défendez dans Hey ! des œuvres souvent très intimes, qui parlent régulièrement du corps, de la façon dont on se perçoit ou dont on perçoit autrui… Et pourtant, depuis le début de l’interview, vous évoquez des mouvements globaux, collectifs.
L’idée de la free, c’est de partager un moment ensemble, c’est communautaire. On est dans l’éphémère, on est dans le maintenant tout de suite, et dans le maintenant tout de suite ensemble. Mais la peinture, et le dessin c’est une histoire individuelle, c’est très différent. Pourquoi est-ce qu’un travail, une peinture, une sculpture, un dessin, un album, une bande dessinée, un film, peut tout d’un coup devenir universel, en tout cas peut devenir collectif, c’est-à-dire parler à tout le monde ?
Ce que j’ai appris, c’est qu’à partir du moment où le travail s’autorise à être réellement personnel, excluant complètement tout le reste, eh bien la chose, le jus que cette production va délivrer, a tellement de justesse, est tellement vrai… Quand on parle de soi, on a sa propre vérité : tu ne peux pas me dire que je dis un mensonge, je parle de moi. Quand je te parle de moi, la chose ne regarde que moi, les contours sont des contours qui n’appartiennent qu’à moi, ce que je mets dedans, ce sont des choses que j’ai fabriquées ou qui sont moi depuis que je suis née… Cette vérité ultime en fait, cet espèce de joyaux, ce truc qui est à l’os vraiment, cette épure magnifique, quand elle est livrée, elle rencontre du monde.
C’est pour cela que dans la revue, je ne cherche pas de lecteur. Quand je fais les numéros… Franchement, hein, la direction d’un numéro, c’est que je surkiffe tout ce qu’il y a dedans. Et je sais que la sélection, c’est vraiment le pur jus du moment, ce que je recherche dans la vie, qui me parle de moi sans que je l’aie demandé du tout. C’est pour ça que c’est trimestriel, pour la liberté de pouvoir présenter totalement autre chose trois mois plus tard, parce que la vie c’est que du mouvement, donc ça change tout le temps.
Regarde le Persepolis de Marjane Satrapi, L’Arabe du Futur de Riad Sattouf, ce sont des gens qui ne parlent que d’eux mais à l’os, profond, au risque de choquer d’autres personnes qui ont vécu la même chose qu’eux, à côté d’eux, mais différemment. Quand tu lis ça, tu rencontres quelqu’un, tu rencontres une vérité, et tout d’un coup cette vérité, finalement, c’est la tienne. En art, quand tu discutes avec les très grands artistes, la seule chose qu’ils cherchent au fil du temps, c’est l’épure. L’idée, la quête d’être toujours au plus juste au moment où tu le dis. Plus tu vieillis, plus tu comprends que ce qui véritablement beau, c’est ce qui te fonde, c’est le puits, c’est là où tu va chercher au plus bas, au plus profond.

For Ever Free
C’est un travail risqué, finalement. Tel que vous le décrivez, c’est extrêmement exigeant, psychologiquement et émotionnellement, non ?
Non, parce que l’art c’est… Si toi-même, en tant qu’artiste, ce que tu produis ça ne te remue pas les tripes, il faut changer de métier. La « Bottom Line » de l’art, c’est quand même l’implication à 100 %. Pour moi, c’est vraiment la définition, et c’est pour ça que les contre-cultures m’intéressent à mort. Parce que quelqu’un qui fait vraiment la contre-culture, même si ce n’est pas un artiste, c’est un faiseur, c’est un créateur, c’est quelqu’un qui va mourir dedans. Il se donne vraiment pour la cause. L’exposition « Tatoueurs, Tatoués » au Musée du Quai Branly, je ne l’ai pas faite en tant qu’artiste, je l’ai faite en tant que commissaire d’exposition, mais l’implication que j’y ai mise, c’est l’implication dont je te parle. C’est pour cela que l’exposition a eu autant de succès. Quand tu fais quelque chose de vraiment habité, ça dialogue avec l’extérieur, c’est mécanique.
Ça a dû demander, au passage, pas mal de travail…
Deux ans et demi de préparation. L’expo, elle, a duré un an et demi et maintenant elle est en tournée internationale, jusqu’en 2020.

Ah oui quand même… Tout à l’heure, on parlait du décalage entre les médias établis et les contre-cultures, et de l’arrivée de la logique commerciale dans les industries culturelles. Si ce dernier point dure toujours, le premier a beaucoup bougé. Comment avez-vous vécu ce tournant, je pense notamment à l’arrivée d’Internet, vous qui étiez précurseurs de cette nouvelle philosophie, de cette nouvelle ouverture ?
Le switch du Net, je l’ai vécu au tout début des années 90. À Paris à ce moment-là est arrivée une communauté, qui avait la tête rasée, qui portait des sandales par tous les temps… C’était ceux de la Silicon Valley. C’est comme ça que j’ai découvert Internet. Et à l’époque, qui est aussi le début de Hey !, il y avait deux visions du monde qui se confrontaient. Très grossièrement, c’était d’un côté la société Kleenex, le tout-jetable, et de l’autre, l’idée de formuler quelque chose qui dure. L’inverse, d’ailleurs, de ce que j’avais vécu avant, quand je décrivais les free parties… C’est plein de paradoxes, entre ce que tu as défendu dix ans avant et, à cause de ce que la société devient, il devient tout à coup crucial d’imposer quelque chose de physique, qui dure, à collectionner, face au tout consommable, au tout fabriqué pour être jeté, dans l’idée l’idée de ne faire que de l’argent, donc le tout financier.
Ce sera le dernier message, si j’ai un message à livrer : l’important, c’est de faire ! Même la toute petite idée peut tout d’un coup prendre une ampleur monumentale, à partir du moment ou on y croit assez et que l’on décide de faire. N’hésitez jamais, jamais, à vous impliquer. Quand on croit à quelque chose, même dans un environnement qui vous dénigre, qui dénigre profondément ce que vous êtes, ou ce que vous faites, ou ce que vous rêvez de formuler. En fait, l’idée c’est de ne jamais s’oublier, de ne jamais, jamais, jamais… jamais oublier ses rêves. Jamais. Et je pense que les rêves costauds, les vrais rêves, les rêves en dur, ils arrivent à partir de l’âge de dix ans. Voilà. La confrontation, c’est le passage au collège. Donc, quand on a dix ans, entre dix et treize-quatorze ans quoi, c’est une espèce de période à chérir, au sens de « ne jamais oublier ce que l’on a projeté, sans entraves ». Sans toutes les entraves que l’on va rencontrer avec le monde adulte, et les questions métaphysiques qu’on va se poser quand les poils poussent.
Hey ! est édité par les éditions Ankama. retrouvez toutes les infos sur la revue, ses parutions, ses événements, ses hors-série sur heyheyhey.fr.
Un immense merci à Anne, pour sa générosité, son accueil et son enthousiasme, à Ophélie, pour son efficacité et sa patience et à Cyprien Rose pour son travail impeccable.






