L’être humain se sert grassement de la planète, les bouleversements climatiques ont commencé et nous allons fort probablement connaitre l’effondrement de la civilisation thermo-industrielle : tel est le constat alarmant de Pablo Servigne, biologiste, au regard des myriades d’études et d’états des lieux d’une planète en très, très mauvaise santé. C’est pourtant lui, aussi, qui nous explique que l’on peut vivre avec cette idée, aller au-delà et tenter d’en atténuer le choc. Par exemple, en réapprenant à s’organiser en réseau ; avec la solidarité comme fondement de nos manières de vivre.
Auteur de Comment tout peut s’effondrer (Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes) et plus récemment de L’Entraide, l’autre loi de la jungle, Pablo Servigne est l’un chercheurs les plus conscients de l’état de notre monde.
Issu d’une formation scientifique académique (ingénieur agronome et docteur en biologie), il s’est découvert une passion pour les mécanismes de l’entraide (coopération, mutualisme, altruisme, etc.), notamment lors de sa thèse sur le comportement et l’écologie des fourmis.
Pendant ses années de recherche, il prend connaissance de publications scientifiques sur le climat, la biodiversité et le pétrole, et pressent l’imminence d’événements graves. Un processus qu’il décrit comme similaire au deuil, avec les mêmes grandes étapes : Incrédulité, culpabilité, colère, marchandage, tristesse, reconstruction, adaptation.
PostAp Mag l’a rencontré et questionné sur sa pensée lucide et (pourtant) optimiste, qui analyse, rassemble, synthétise et rend intelligibles les phénomènes les plus inquiétants de l’époque, mais ouvre aussi des pistes intellectuelles, et même organisationnelles, pour survivre à l’effondrement total de nos sociétés industrialisées. Une catastrophe globale qui lui paraît inévitable, tant sur les plans économiques qu’écologiques ou politiques.
C’est pourquoi nous avons souhaité lui demander comment survivre à la fin du monde, et comment garder le moral au cœur d’un cataclysme… Qui a peut-être bien déjà commencé.
Un constat réaliste
Postap Magazine. Comment décide-t-on d’écrire sur « l’effondrement qui vient » ?
Pablo Servigne. Ce n’était pas une priorité à l’origine… Je suis biologiste de formation et mon dada, depuis plus de dix ans, c’est l’entraide : comment elle fonctionne dans la nature, chez les animaux et les insectes. Mais en découvrant l’ampleur des catastrophes écologiques qui se profilent, ou qui sont déjà en cours, la question est devenue urgente pour moi. Avec mon co-auteur, Raphaël Stevens, tout est allé très vite, dès qu’on a commencé à écrire. On a terminé le livre en trois mois. Mais nous avions des années de données, d’études et de réflexions accumulées dans nos travaux respectifs. La question continue à me passionner, parce qu’elle répond à une intuition qui est largement partagée, très présente, pour beaucoup. Les rencontres avec le public, lors de conférences, qui sont très riches et font avancer le débat, me font prendre conscience que la question de la fin possible du monde tel qu’on l’a connu tracasse bien au-delà de ma petite personne.
P.M. C’est plus qu’un travail, c’est une mission…
P.S. Pour ce qui me concerne, c’est d’abord un champ d’étude, que j’appelle la « collapsologie » (du terme latin « collapsus, qui signifie précisément « effondrement », ndlr). C’est dans ce cadre, que j’en viens à me qualifier de « chercheur in-terre-dépendant ». Ce jeu de mots me sert à faire comprendre, à rappeler, que l’on travaille en réseau, entre chercheurs de toutes disciplines bien sûr, mais aussi avec les non humains au quotidien, sans qui il n’est pas de vie possible.
On est donc tous dans le même bateau, en fait, et, finalement, cela n’a pas de sens d’être indépendant, même si je suis sorti du système académique aujourd’hui. Pour moi, mon travail reste de la recherche, car je développe de nouvelles idées, je les transmets, je recoupe. Ma méthode est très rigoureuse et je travaille sur les thèmes que j’ai choisis : l’agriculture du futur, l’effondrement, la résilience, l’entraide, les imaginaires et, également, sur l’avenir des villes.
P.M. On va parler de ce que l’on peut faire mais, avant, il nous faut discuter du constat. Pour vous, l’un des premiers points de rupture, une source probable de l’éclatement de crises en série, ce serait l’économie. Pourquoi ?
P.S. On parle de crises, mais ce n’est pas le bon mot. Car il s’agit bien plutôt de catastrophes. Climat, biodiversité, finances, infrastructures, migrations, guerre, épuisement des ressources… Chacune d’entre elles a une dynamique différente, mais tout est interconnecté. La logique veut que l’effet déclencheur provienne des dynamiques les plus rapides, avant de se répandre vers les autres, de proche en proche. Or la finance, c’est ce qu’il y a de plus fragile et de plus rapide.
En finance, des opérations ont lieu à l’échelle de la milliseconde, de la nanoseconde. Toute crise financière, bien entendu, a des conséquences directes sur l’économie, qui elle est de l’ordre de la semaine ou du mois. Les questions énergétiques, les questions de biodiversité et de climat, pour leur part, se comprennent plutôt à l’échelle de l’année puis, respectivement, de la décennie, du siècle, du millénaire… Et la question nucléaire, par exemple celle du stockage des déchets, se pose elle en millions d’années. Certes, il peut y avoir une catastrophe nucléaire maintenant. Mais si cela arrive, il va d’abord y avoir des conséquences sur la finance, l’économie, puis le social et le politique, bien avant que celles sur la nature ne se fassent ressentir… C’est ça qui me fait dire que pour l’instant, le maillon faible, c’est la finance. Cela ne veut pas dire que c’est le plus grave ou le plus mal en point. Cela veut dire que c’est ce qui peut craquer en premier, et le plus rapidement…
P.M. Vous redoutez un effet domino ?
P.S. Oui, car toutes ces crises sont liées. C’est à cause des sphères financières, économiques et politiques que se prolongent et s’aggravent les catastrophes, déjà en cours, qui sont écologiques, énergétiques et sociales… Et qui ont des impacts, en retour, sur l’économie, la politique, la finance. Or, cette interconnexion n’est presque jamais abordée dans les médias, ni même en science, d’ailleurs. Tout est cloisonné. La pensée est cloisonnée. On invite un climatologue pour parler du climat, mais on n’invite jamais, à côté, un spécialiste du pic pétrolier ou des centrales nucléaires, pour montrer les interconnexions entre les crises.
« Ma posture, c’est que je n’ai pas envie de survivre, j’ai envie de vivre. Tout mon travail, c’est d’explorer la différence entre survivre et vivre, de créer quelque chose de plus sympathique à vivre, malgré toute la lucidité de la catastrophe et de souffrances qui se profilent. »
Bien entendu, chaque discipline évalue le niveau de risque de ce qu’elle étudie. Mais on constate que la somme est plus forte que l’ensemble des parties, que tous les risques pris indépendamment sont toujours inférieurs, moins graves que le risque global. Ceux qui calculent et analysent les risques systémiques montrent que c’est toujours plus grave, plus probable et plus rapide. C’est ça, le grand écueil de la mondialisation. On a tout interconnecté de manière homogène, et ainsi créé un risque systémique global, qui rend la situation très fragile. On arrive à ce paradoxe qui traverse le livre : plus notre civilisation est puissante, plus elle est vulnérable. C’est cette vulnérabilité que l’on n’arrive pas à voir. À laquelle nous n’arrivons pas à croire.
P.M. « Notre » civilisation ? Ou « les » civilisations ?
P.S. Je parle plutôt de « civilisation thermo-industrielle », donc tout ce qui consomme des énergies fossiles. Après, la question climatique et la question nucléaire sont les deux menaces qui élargissent le spectre, qui peuvent détruire non seulement plus que la civilisation thermo-industrielle (car il en reste encore quelques unes, quand même), mais aussi les non-humains, j’entends par là : une grande majorité des espèces de notre Terre. Si l’effondrement va vraiment jusque-là, il faudrait plutôt parler de risque global, écosystémique, d’une autre échelle. Là, la question n’est plus celle de la civilisation, mais de la vie même, du système monde, du système terre.
Après l’effondrement
P.M. Bon, passons aux bonnes nouvelles. Au fond, vous décrivez l’imminence d’une —ou plusieurs— catastrophe vraiment sérieuse, mais vous envisagez, malgré tout, qu’il y ait des survivants. Ce qui se profile pourrait être l’effondrement d’une civilisation, une catastrophe terrifiante avec des injustices, des dictatures, des guerres et des morts… Mais quand même avec des survivants, des sociétés et des manières d’être qui se perpétuent, qui se reconstruisent, qui s’inventent.
P.S. C’est de l’ordre du possible, oui. C’est un constat philosophique en fait, ou plutôt épistémologique. À savoir que l’on ne peut pas prouver avec certitude que quelque chose aura lieu, ni comment ; pas plus qu’on ne peut prouver que ça n’aura pas lieu. C’est impossible scientifiquement d’en avoir la certitude. Donc, on parle toujours de possibles, et parmi ces possibles, il y a effectivement les survivants. Partant de là, s’il est possible que personne ne survive, il faut quand même explorer l’autre piste. Or, l’être humain est une créature des plus résilientes et résistantes.
P.M. À condition que les humains œuvrent dans le même sens…
P.S. Justement, je pense que si l’on s’y met, on peut limiter les dégâts… Ce qui augmente la probabilité qu’il y ait des survivants ! Donc, allons-y, pourquoi pas, imaginons ces survivants. C’est l’idée. Et puis, moi, j’ai envie de vivre la suite. Donc, imaginons non seulement qu’il y ait des survivants, mais aussi que l’on en fasse partie… En fait, je vais même plus loin : ma posture, c’est que je n’ai pas envie de survivre, j’ai envie de vivre. Tout mon travail depuis le tome 1 (car nous sommes en train d’écrire le tome 2), c’est de voir quelle est la différence entre survivre et vivre, d’explorer cela et de le développer. De créer quelque chose de meilleur, de plus sympathique à vivre, malgré toute la lucidité de la catastrophe et de souffrances qui se profilent.
P.M. Ni pessimiste, ni optimiste ?
P.S. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais juste qu’il faut faire de notre mieux, point barre. Je ne dis pas que c’est foutu, et je ne dis pas que tout va aller bien, je ne connais pas l’avenir, j’essaie d’être plus le lucide possible, et avec le plus de bienveillance possible. Je pense que c’est l’attitude la plus saine pour moi.
P.M. Le problème, c’est que même pour limiter, voire éviter, l’effondrement, il faut agir… Donc, il faut avoir conscience de ce qui pourrait arriver.
Et quand on regarde certaines personnes, on voit…
P.S. Du déni…
P.M. Oui, si on pense à ces personnes qui ont besoin d’aller bosser, qui ont des enfants à élever et qui finalement n’ont pas trop de temps à consacrer au futur, tant elles sont prises par le présent. Mais ce qui est plus dur à comprendre, ce sont les individus bien informés qui poussent au contraire à aller plus loin : plus de pétrole, plus de chimie dans les champs, plus de clonage animal pour nourrir l’humanité… Qu’est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là ? Vous avez bien dû vous poser la question, je suppose ?
P.S. Eh bien… On ne change pas le monde du jour au lendemain. Il y a un verrouillage. En quelque sorte, nous sommes verrouillés sur une trajectoire que l’on a prise et il est très difficile d’en sortir, du fait à la fois de la taille de nos sociétés, de la puissance accumulée, et de mécanismes psychologiques, sociologiques, techniques, politiques, économiques, bien en place et bien connus. Aujourd’hui, on est dans une ornière, on a du mal à en sortir, on a du mal à prendre le virage qu’il faudrait pour entamer une transition, ou un changement de cap. On est pris dans un système, on travaille, on a un boulot, un salaire, un système politique… Tout cela nous fait continuer avec une grande inertie, à aborder le XXI° siècle avec une pensée du XX° voire du XIX°. En parallèle, la question de l’effondrement c’est la question de la mort, de notre mort. Et nous en parlons très peu dans notre société, elle est très mal abordée, ou traitée. C’est pour cela que nous avons peur, par ignorance.
« Le terrain de lutte est en grande partie dans l’imaginaire, dans notre manière de se représenter le monde et le futur, et pas seulement du côté de la raison. Il y a un grand effort à faire du côté des récits et des histoires que l’on se raconte, des fictions. »
P.M. La mort impressionne…
P.S. C’est beaucoup plus confortable de continuer la vie comme on l’a imaginée, ou comme on l’a vécue avant, donc de continuer la croissance, la culture industrielle, les OGM… Tout ça, c’est le progrès linéaire, une vision linéaire de l’évolution des sociétés.
P.M. L’espoir est confortable ?
P.S. Il est très confortable, et il s’appuie sur trois siècles de progrès techniques indéniables qui rassurent, en partie. Ça « marche », en partie, entre guillemets même, pour certaines personnes, dans certains cas. Ça détruit tout le reste autour, mais ça, on peut toujours en faire abstraction. Sauf quand on « dézoome », qu’on voit le tableau général. Alors, on voit non seulement que ça n’est pas tenable mais aussi que ça va pas tenir. Moralement, ce n’est pas acceptable. À un moment, il faut avoir le courage de sortir du déni. Mais bien sûr, ce n’est pas qu’une affaire de courage. Il faut avoir le temps, les capacités, sociales, psychologiques, intellectuelles, financières.
D’un monde l’autre
P.M. Nous ne sommes pas prêts, alors…
P.S. Je pense que tout le monde n’en est pas encore là, c’est pour ça que l’on voit aujourd’hui des gens qui pensent encore que tout peut continuer comme avant, et d’autres qui pensent que tout ne peut pas continuer comme avant. Voilà les frictions, et les frictions elles seront là, encore présentes pendant des décennies.
P.M. Des frictions… Comme à Notre-Dames-des-Landes ?
P.S. Oui, c’est un point chaud de notre époque. Et passionnant, car la question oppose des gens qui luttent pour plus d’emploi, pour plus de croissance, plus de prospérité, à d’autres qui disent : « Mais ça ne sert à rien votre truc, puisqu’il n’y aura plus d’avion dans dix ans. »
P.M. Qui a raison ?
P.S. Les deux ont raison, mais ils ne sont pas sur le même imaginaire, pas sur la même manière d’être au monde, n’ont pas la même manière de voir l’avenir ou de se le représenter. Ils ne peuvent donc pas se comprendre, et là est vraiment un point de friction, de tension, de cisaillement de notre époque. C’est assez beau, au fond. Pour cette raison, je suis persuadé que le terrain de lutte est en grande partie dans l’imaginaire, dans notre manière de se représenter le monde et le futur, et pas seulement du côté de la raison. Il y a un grand effort à faire du côté des récits et des histoires que l’on se raconte, des fictions.
Il faut donc subir un grand déclic psychologique, c’est-à-dire accepter de tout faire pour bien vivre l’effondrement. C’est ça la clé, il ne faut pas chercher à l’éviter.
P.M. Vous dites que les deux ont raison mais qu’ils n’ont pas le même imaginaire. Comment peuvent-ils avoir tous raison sans partager un même imaginaire ? Comment peuvent-ils se comprendre et parler de façon raisonnée ?
P.S. Ils ont raison dans le sens où leur réponse propre répond à leurs attentes, les arguments sont rationnels des deux côtés. Il y en a qui veulent simplement un job, sortir de la mouise, et ils croient vraiment que l’aéroport va leur apporter du boulot, donc un salaire, et donc à manger pour les enfants. Je caricature un peu, mais si tu ne vois que cela, tu as forcément raison, tout est logique. Après, si tu commences à t’intéresser à d’autres choses, je ne sais pas moi, les batraciens par exemple, la biodiversité, le CO2 dans l’atmosphère, les grandes crises climatiques… tu as alors raison de penser que ce n’est pas logique de développer un aéroport. Si tu es riverain, le bruit et le trafic, ça va te gêner, tu as également raison de t’opposer… En fait, il y a plein de raisons de s’opposer, et il y a plein de raisons d’être d’accord.
P.M. Tout le monde a raison, mais chacun doit étendre sa vision ?
P.S. Chacun peut être dans son petit monde, mais si l’on élargit et que l’on voit le tableau global, il y a un pas en plus à faire. Qui est de montrer que non, ce n’est pas qu’une question de volonté : il n’y aura vraiment plus d’avion, cela ne peut plus durer, ce n’est pas logique d’investir dans cette industrie. L’effondrement n’est pas un choix politique, ça va arriver, il faut juste s’y préparer. Donc, ceux qui pensent ça ont aussi raison.
Cela fait des visions totalement contradictoires. Peut-être me posez-vous la question car, pour vous, avoir raison serait synonyme de dire la vérité, au sens d’une vérité absolue, scientifique. Mais il ne s’agit pas de cela. Chacun a ses raisons, c’est dans ce sens-là que j’emploie le mot « raison ». La vraie question est politique : quel monde cherche-t-on à construire ensemble ? A-t-on vraiment envie de construire quelque chose ensemble ? Si oui, allons-y, discutons. Si non, alors on ne s’entendra jamais.
P.M.Il est donc déjà trop tard ? Pour vous, quelque chose va arriver : on ne sait pas exactement quand, ni quoi, mais il serait de toute façon déjà trop tard pour l’éviter ?
P.S. Oui, et il faut l’accepter… Mais c’est trop tard pour quoi ? Il faut toujours préciser de quoi on parle, au juste. Il est trop tard pour continuer la trajectoire, et c’est aussi trop tard pour le développement durable, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire et que tout est foutu. Selon moi, tout ce que l’on fait et tout ce que l’on fera servira à ralentir et atténuer les effets d’un effondrement. Ce qu’il faut maintenant accepter, c’est que l’on va vivre cet effondrement. Il faut donc subir un grand déclic psychologique, c’est-à-dire accepter de tout faire pour bien vivre l’effondrement. C’est ça la clé, il ne faut pas chercher à l’éviter.
P.M. Souvent les déclics psychologiques ne se produisent pas du fait d’un livre ou d’une pensée rationnelle, mais d’un événement, d’une image, d’un choc…
P.S. Je prends toujours la métaphore de l’arbre dans la forêt : il y a un grand chêne qui est en train de s’effondrer. Il ne faut pas passer de l’énergie et du temps à essayer d’éviter sa chute, il faut plutôt se consacrer à nourrir les jeunes pousses qui vont émerger du fait même que le grand arbre s’effondre. Je ne vais pas employer le mot « positif », mais il y a quelque chose de l’ordre de l’action et de l’enthousiasme là-dedans. On n’est pas du tout à se morfondre et à dire que tout est foutu et qu’il ne faut rien faire, au contraire. C’est justement parce qu’il y a un effondrement que l’on doit se bouger. Il est là, le grand déclic psychologique à avoir. Par psychologique, j’entends surtout une rupture imaginaire, dans notre représentation du monde, et donc de l’avenir.
P.M. Bon, alors, désolé pour la question bête, mais allons-y : Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait, Pablo ?
P.S. Avant de répondre, je voudrais préciser qu’il y a trois manières d’aborder l’effondrement. La première, c’est le constat. Les faits. C’est ce qui est en train d’arriver, c’est au centre. C’est ce que l’on a essayé de faire dans notre livre, être le plus clair possible, avoir le raisonnement le plus lucide possible, pour essayer de s’entendre là-dessus, avec le plus grand nombre possible de personnes.
Là-dessus, se greffent deux postures conflictuelles. La première, en amont, ce sont les causes : « Pourquoi en est-on arrivé là ? ». Et là, tout le monde se chamaille. Certains vont dire : « C’est le capitalisme », d’autres : « Non, c’est le pouvoir ». « Mais non, c’est le manque de pouvoir », « Ah non ! C’est la croissance », « Mais non, c’est le néocolonialisme » ; « Moi, je dirais que ce sont les gauchistes », « Et les fascistes, alors ? » Tout le monde met les « ismes » qu’il veut, mais l’on se chamaille et ça fait des articles et des bouquins à n’en plus finir. Chacun a sa petite raison, et c’est une question collapsologique importante, mais ce n’étais pas ça qui nous intéressait pour ce premier tome.
La seconde manière de se chamailler, en aval, une fois que l’on a le constat, c’est : « Qu’est-ce qu’on fait ? » Là, certains vont dire : « Il faut s’organiser », et d’autres : « Mais non, il faut voter », et d’autres « Surtout pas, il faut arrêter de voter », et d’autres, « Mais non, il faut construire une Europe meilleure », « Mais non, il faut abandonner l’Europe », « Mais non il faut construire une cabane, y mettre des vivres et s’acheter une arme », « Mais non il ne faut pas faire ça »… Encore une fois tout le monde se bat, chacun a sa posture et c’est vite fatigant.
P.M. On peut trouver un terrain d’entente ?
P.S. Selon moi, il faut, dans un premier temps, se concentrer sur ce qui est au milieu. C’est-à-dire les faits. Et il faut être conscient, lucide et très clair sur ce qui se passe, pour que chacun utilise ses petits outils conceptuels, sa trousse à outils, pour ensuite faire ce qu’il ou elle veut. Que chacun interprète à sa guise les causes et réagisse selon ses convictions. Ceci étant dit, il y a plein de choses à faire, à tous les niveaux. C’est la question de la politique de l’effondrement : que fait-on, collectivement ? Certes, il y a beaucoup de choses à faire individuellement, et c’est toute la question du mouvement survivaliste. On a tous un survivaliste en nous, et il y a plein de manières d’être survivaliste, mais ce n’est pas mon propos ici. Ce qui m’intéresse, c’est le chantier politique. On pourrait en discuter des heures, et il y a plein de pistes, c’est un grand chantier et c’est pour ça que je ne peux pas y répondre maintenant.
P.M. On favorise trop l’action par rapport à la réflexion ?
P.S. Je trouve que les gens ont souvent tendance à passer à l’action trop vite. Mon sentiment est qu’il faudrait explorer le champ de la psychologie de l’effondrement plus en profondeur, avant de se lancer dans n’importe quoi. Je pense qu’il est sage de travailler sa posture, sa manière d’être avec les autres, avec nous-même, avec le monde, avec l’avenir, avec le passé, etc. Je pense que c’est ça, l’étape importante : après avoir compris, mais avant d’agir. C’est une sorte de « transition intérieure », comment on se comporte, comment on retrouve du lien, comment on crée du sens à notre monde, à notre façon d’être au monde, pour pouvoir faire des choses justes.
Je pense qu’il est sage de travailler sa posture, sa manière d’être avec les autres, avec nous-même, avec le monde, avec l’avenir, avec le passé… Je pense que c’est ça, l’étape importante : après avoir compris, mais avant d’agir.
J’ai l’impression que si on part trop vite dans l’action, avec notre imaginaire du XX° siècle, voire du début du XXI°, si l’on n’a pas fait un changement très profond avant, on va faire des bêtises. Je ne suis peut-être pas le seul à penser cela, peut-être qu’il y en a qui ne sont pas d’accord, mais c’est aujourd’hui l’objet de nos recherches, avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Nous en sommes convaincus. Si jamais on écrit sur la politique de l’effondrement, ça sera un tome 3, ou un tome 4 ! [Rires] Mais, pour l’instant, il s’agit vraiment de creuser la psychologie de l’effondrement, d’apprendre à vivre avec. C’est une grande étape du « Que faire ? ».
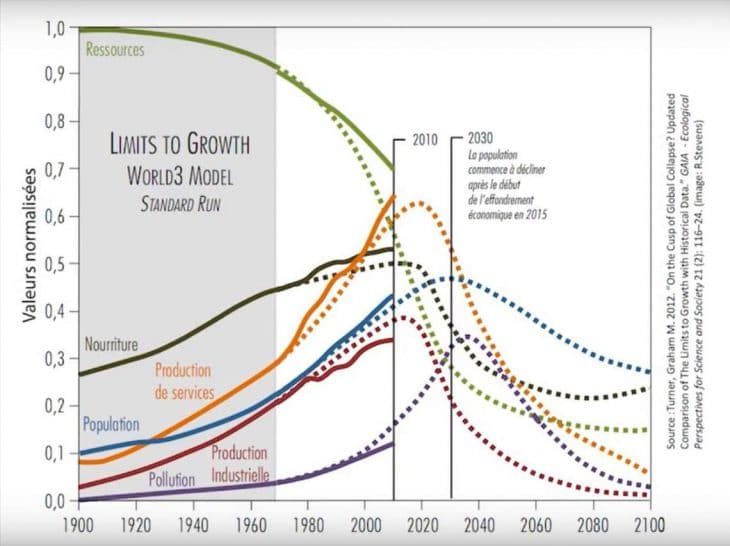
L’art face au monde
P.M.Vous avez rencontré beaucoup de monde depuis la sortie du livre, vous êtes assez actif, vous faites des conférences, vous travaillez avec des artistes… Qu’avez-vous constaté ? Quelles sont les préoccupations ?
P.S. De manière générale, on a croisé un public très diversifié, c’est passionnant.Ces deux dernières années, nous avons été invités dans les universités, dans les partis politiques, les associations, les salons du livre, des chambres d’agriculture, des militaires, des patrons, des administrations mais aussi des artistes. Ce qui est fou, c’est qu’à chaque fois… ce sont les mêmes questions ! Par exemple : « Est-ce que l’on va s’entretuer ? »
P.M. Un peu comme une angoisse fantasmée ?
P.S. Chez tout le monde, on retrouve cette peur, cette tristesse, cette excitation et cette colère. En fait ce thème de l’effondrement est obsédant. Une fois qu’il s’accroche, il ne vous lâche plus, c’est pour la vie. Chez les artistes, c’est une sorte de résilience, ils subliment ces thèmes dans leurs œuvres, c’est magnifique. Ceux qui m’ont contacté veulent créer sur ce thème de l’effondrement, que ce soit en BD, en roman, en film, en pièce de théâtre, en spectacle de danse… Donc ça rejoint un peu ce que nous disions dans le livre, c’est-à-dire que faire un essai sur l’effondrement et comprendre ce qui se passe, ce n’est que 10 % du chemin.
P.M. Il faut passer de la raison à l’imaginaire ?
P.S. Oui, aux émotions et à l’imaginaire. Car on a besoin de récits, d’histoires, de fiction, on a besoin de s’identifier à des personnages, de danser les choses, de pleurer, de faire la fête. Les émotions et l’imaginaire sont deux grands champs pour avancer. En ce qui concerne les artistes, pour moi une des priorités, en parallèle des préparations individuelles, ou collectives, ou politiques, c’est d’explorer le champ des récits qui ne soit pas caricaturaux, et qui donne envie d’aborder le futur de manière lucide. En gros, qui ne soit ni dystopique, genre Mad Max ou La Route, ni utopique, genre La Belle Verte, que j’aime bien par ailleurs —et j’aime bien Mad Max aussi— mais qu’on puisse naviguer dans des imaginaires plus fins, moins archétypaux, moins caricaturaux. .
P.M. C’est ce que vous attendez des artistes ?
P.S. Qu’ils soient à l’avant-garde de l’imaginaire du futur, avec bienveillance et lucidité. Je trouve que les dystopies sont trop tournées vers la peur. On cherche à faire peur, je comprends, et c’est bien, mais c’est une partie du problème. Ok, tout le monde a peur, mais on n’avance pas qu’avec la peur. Il faut des récits sur la tristesse et le désespoir, sur la colère, des récits sur la joie et l’enthousiasme qu’il y a à dessiner l’avenir et, en fait, il faut même mieux que cela, il faut mélanger tout ça. Il y a plein de thèmes à trouver, à dérouler, plutôt que seulement la peur et la réponse par les armes et la loi du plus fort.
Retrouvez Pablo Servigne, ses conférences et son actualité sur Pabloservigne.com, ou préparez l’avenir grâce au DECOLL, le Département de Collapsologie générale et appliquée, sur collapsologie.fr.






