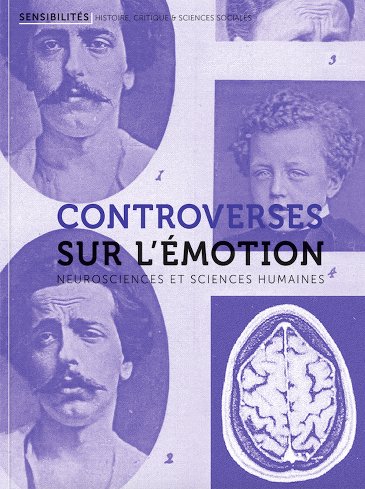De nos rêves, nous connaissons nos souvenirs épars au matin ; des rêves des autres, ce qu’ils veulent bien nous en dire. Du moins c’est ce qu’on croit. Car des rêves, en réalité, nous savons beaucoup. Pas seulement ce que la psychanalyse ou les autres sciences de la psyché ont à en dire, mais aussi ce que nos semblables, par-delà les époques, les continents et les cultures, en ont raconté. Et, bien qu’on l’ignore souvent, depuis des siècles, ils et elles en ont raconté, des rêves !

Mais que faire de ces récits ? La revue Sensibilités, qui réunit pour son dernier numéro « La Société des Rêves » (éditions Anamosa) psychanalystes, anthropologues, sociologues et historiens, a décidé d’en ouvrir la porte grâce à des passe-partout jusqu’ici trop peu usités : la sociologie et l’histoire du fait onirique. Et ce pour dire la façon dont, au plus intime de l’individu, s’expriment ses appartenances sociales, générationnelles, sexuelles, etc. Mais aussi, comment, par delà les mystères proprement psychanalytiques, les traditions, les héritages culturels, les relations économiques et, dans tout cela, l’inexorable marche de l’histoire et des savoirs nous changent, nous influencent et nous construisent jusque dans nos rêves.
C’est cela que nous avons cherché en décidant d’interviewer Hervé Mazurel, l’un des deux coordinateurs de ce numéro 4 de Sensibilités, et nous avons trouvé bien plus, un début d’esquisse d’une nouvelle vision de l’humain, seul ou seule face au monde, mais aussi de notre espèce dotée de ce qu’on nomme, sans bien savoir ce que c’est, la conscience. Poussez sans frémir ces portes d’ivoire ou de corne : par-delà le seuil de nos nuits, les enseignements sont multiples et le guide, chaleureux.

De l’histoire des sensibilités à la sociologie des rêves
P.M. Qui êtes-vous, et d’où venez-vous ?
Hervé Mazurel. Puisqu’il faut avouer : avouons. Je mène une double-vie. Outre celle d’universitaire, une vie de musicien, au sein d’un groupe qui s’est d’abord appelé Jack the Ripper, puis Fitzcaraldo Sessions, puis finalement Valparaiso. J’ai toujours travaillé comme musicien aussi, c’est un point d’équilibre dans ma vie.
P.M. Quel instrument ?
H.M. Je joue de la guitare, électrique ou acoustique, du banjo,du ukulélé, de la mandoline, bref tout ce qui se gratte de haut en bas, à peu près [Rires]. Et puis à côté de ça, je suis historien, mais très tourné vers l’anthropologie : un historien du corps, de la vie affective, des sensibilités, des imaginaires. C’est par ce biais-là que j’en suis venu à m’intéresser au rêve, parce que les historiens de la vie affective, finalement, se sont assez peu confrontés à la psychanalyse, et aux psychanalystes. Il y a là une sorte de non-rencontre, en quelque sorte, entre les psychanalystes, qui sont pourtant de grands spécialistes des affects, et les historiens des sensibilités. Je voudrais essayer de créer des ponts entre ces deux mondes…
La question du rêve m’a toujours intéressé mais cela a pris un nouveau tournant quand j’ai été mis en contact via la revue avec Bernard Lahire, un immense sociologue qui travaillait sur ce terrain-là (je l’ignorais il y a encore un an). Il m’a dit en deux mots: « Voilà, je travaille sur la sociologie des rêves, c’est un travail que je prépare depuis vingt ans » (paru depuis sous le titre L’interprétation sociologique des rêves, NDLR). Il avait envie qu’on fasse travailler ensemble le temps d’un numéro des historiens, des sociologues, des anthropologues et des psychanalystes, autour d’un certain nombre d’hypothèses… Dont on va parler, je suppose [Rires] ?
P.M. Oui mais d’abord, « historien des sensibilités », qu’est-ce que ça veut dire ?
H.M. Un historien des sensibilités, c’est un historien qui considère que les émotions, les sentiments, ont une histoire. Qu’ils et elles ne sont pas fixes à travers le temps, qu’ils et elles ne sont pas invariables, mais qu’en fait la culture à laquelle on appartient —et les groupes sociaux dont on vient— imprègnent très fortement nos façons de sentir et de ressentir, nos manières d’être au monde finalement. Pas seulement les sentiments et les émotions d’ailleurs, mais les sens, aussi. On a l’impression que les sens, les perceptions sensorielles, c’est quelque chose de très physiologique, de naturel et non de culturel. Mais même nos sens sont pétris d’histoire, tout imprimés d’histoire. (Par exemple, on peut remarquer que les Grecs anciens décrivaient la mer comme « pourpre » ou lie-de-vin », mais jamais comme « bleue » ! NDLR)
C’est comme… En fait, un nouveau-né, au départ, peut recevoir toutes les cultures du monde. Son rapport sensible et affectif au monde. Mais il doit apprendre à s’y orienter et à communiquer avec autrui, de manière verbale ou non. D’où l’extrême importance de sa socialisation. En matière affective, la culture à laquelle il appartient va lui apprendre à reconnaître certains goûts, certains sons, certaines odeurs, à les apprécier ou à les détester, de même qu’on va lui apprendre à exprimer ses émotions de telle ou telle façon, à rire de telle ou telle manière, à pleurer ou à ne pas pleurer, à être pudique ou pas et jusqu’à quel degré… Tout ça, in fine, c’est le produit d’une socialisation culturelle et donc d’une histoire fondamentalement sociale. Ce qu’il s’agit de montrer, c’est comment l’histoire travaille jusqu’au plus intime de nous-mêmes.
Généralement, quand on parle de l’histoire, on parle des événements extérieurs, de l’histoire à grands fracas en dehors de nous, « de l’Histoire avec une grande H » comme disent les enfants. Mais moi, l’histoire qui m’intéresse le plus, c’est l’histoire du dedans, c’est l’histoire qui nous façonne de l’intérieur en tant que sujet, ce sont les couches d’histoire collective sédimentées, déposées en nous sans que nous en ayons conscience… En réalité, nous sommes pétris d’histoire jusqu’aux tréfonds de notre psychisme, et bien souvent, on l’ignore (un thème merveilleusement décrit, si vous voulez notre avis, par Antoine Blondin dans son œuvre romanesque et notamment son premier livre, L’Europe Buissonnière, NDLR). Je ne parle pas seulement du poids de notre histoire individuelle, mais bien de l’histoire collective telle qu’on l’a intériorisée. Voilà un peu le projet d’histoire des sensibilités.
P.M. Vous avez passé une thèse ?
H.M. Oui, mais les thèses sont toujours très spécifiques… Pour ma part, j’ai travaillé sur les expériences combattantes au XIX° siècle. Il y a tout un courant dit « d’anthropologie historique de la guerre moderne », qui cherche à saisir la guerre au ras du sol ; à retrouver le expériences des simples soldats, les violences du champ de bataille vécues à fleur de peau, les expériences corporelles et psychiques du combat, les traumas aussi qu’il génère chez les individus qui le traversent.
Plus précisément, j’ai travaillé pour ma part sur un conflit méconnu aujourd’hui mais qui ne l’était pas du tout au XIX° siècle : la guerre d’indépendance grecque (1821-1830), durant laquelle un gros millier de volontaires occidentaux sont partis aider les Grecs, sur place, à se libérer du joug ottoman. Ce qui a rendu célèbres ces « philhellènes », c’est la présence de Lord Byron dans leurs rangs. Byron était la grande figure littéraire du temps ; il était aussi connu que Goethe et il est mort là-bas en 1824. Des Européens et des Américains se sont engagés dans ce qui ressemble aux premières brigades internationales, celles qu’on verra resurgir lors de la guerre civile espagnole (1936-1939). Ils voulaient payer leur dette aux Anciens et faire renaître la Grèce ancienne… À cela s’ajoutait une dimension de croisade, aussi, parce que l’affrontement des Grecs et des Turcs réveillait cette mémoire longue de la lutte du christianisme et de l’Islam. On y assista également aux débuts de ce qu’on appelle aujourd’hui l’humanitarisme. Il y avait là une forme de souffrance à distance.
Cette émotion collective m’intéressait d’autant plus qu’elle était aussi le produit d’un fantasme collectif à l’égard de la Grèce, vue comme le berceau de l’Occident. Or sur place, les Grecs ne ressemblaient pas aux Grecs qu’ils avaient imaginés, c’est-à-dire aux Grecs anciens [Rires]. Et dans le même temps, il faut garder en mémoire que ce conflit a été le lieu d’une violence vraiment extrême, d’une guerre exterminatrice, la religion ajoutant son surcroît de guerre à la guerre. Beaucoup de soldats sortaient des guerres napoléoniennes, les avaient vécues, mais furent choqués de cette extrême violence, des pratiques de cruauté qui s’y déversaient et beaucoup, et pas seulement les jeunes, sont rentrés profondément traumatisés.
Pour l’historien, c’est là que ça se corse. Parce que pour l’historien à ce moment-là, toute la question, c’est de savoir s’il peut utiliser des termes psychiatriques construits beaucoup pour plus tard pour rendre compte de leur expérience. On peut imaginer remonter à la psychanalyse telle qu’elle s’est établie à la fin du XIX° siècle ou à la psychiatrie de guerre du début du XX° siècle, mais ce pis-aller ne répond pas du tout à la question : est-ce qu’on peut utiliser les termes psychiatriques ou psychanalytiques à deux siècles de distance, ou est ce qu’on risque ainsi l’anachronisme psychologique ? Et sinon, comment parler de tout cela ? Avec quelles lentilles ? Avec quelle certitude que l’on comprend mieux les êtres et les ressorts de l’histoire telle qu’elle s’est produite ? Parce que les individus sur lesquels on travaille ne sont pas tout à fait les mêmes que nous : il faut retrouver la distance à la fois temporelle et culturelle qui nous sépare d’eux. À maints égards, ils étaient, sur bien des sujets, profondément différents de nous.
P.M. Et donc, comment on résout cette problématique ?
H.M. La question, quand tu es historien des sensibilités, c’est d’essayer de retrouver le vécu de ces hommes, au plus près de leurs textes, des images, des objets qui sont arrivés jusqu’à nous. Et le problème pour l’historien, c’est d’échapper ainsi au présent, à ses prismes, à une lecture anachronique ou téléologique du passé. Ce qu’il faut dès lors, c’est s’immerger dans une époque jusqu’à ce qu’elle finisse par résonner en soi, plus que nous ne raisonnons sur elle. Ayant travaillé tellement sur l’époque romantique, je suis plus ou moins à même d’essayer de restituer le vécu sensible, affectif et psychique, de ces hommes et ces femmes d’autrefois. Et par là de tenter de montrer jusqu’à quel point ils nous ressemblent, jusqu’où ils différent de nous. Dans leur manière de sentir, d’être, de se comporter, de penser ou de ne pas penser. Même si tout cela est forcément imparfait et incomplet, c’est une démarche historique qui me paraît incontournable. Une démarche compréhensive.
Ce que je veux dire, au fond, c’est qu’il faut essayer de retrouver les cadres de l’expérience qui étaient les leurs. C’est très proche ici, quoiqu’à travers l’archive, du travail de terrain de l’anthropologue. C’est un peu le même geste qu’un anthropologue qui s’en va dans une communauté très lointaine et qui est obligé de se dépouiller de sa propre culture pour tenter de comprendre de l’intérieur une communauté quelle qu’elle soit. Et ce, sans être ethnocentrique, sans tout ramener à sa propre culture. C’est exactement le même geste mais, au lieu que ce soit dans l’espace, c’est dans le temps.

L’histoire de l’histoire des rêves
P.M. Et donc le propos de ce numéro de Sensibilités, c’est l’histoire sociologique des rêves. Mais pourquoi ?
H.M. Parce que les sciences sociales ont quelque chose d’important à dire sur les rêves. Sur leur imprégnation par le social (les inégalités, les ambitions, les frustrations, les dominations sociales qui s’y expriment). Or ce n’est pas très connu. On en sait beaucoup plus long sur l’histoire des interprétations savantes, du type psychanalytique ou, plus récemment neuroscientifique…
P.M. Et avant, ce qu’on connaît bien aussi comme « interprétations savantes des rêves », ce sont les présages liés aux religions, c’est ça ?
H.M. On parlerait plutôt des interprétations populaires des rêves, ce qu’on appelait la tradition des « clefs des songes » : quand on reconnaît tel ou tel symbole, qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce que ça signifie, quel est le présage qu’il faut lire dans tel ou tel moment du rêve ? Tout cela, on connaît assez bien, et depuis assez longtemps. Grâce notamment aux travaux dirigés par l’historienne Jacqueline Carroy, grande spécialiste de l’histoire des rêves. Mais pour Bernard Lahire, les sciences sociales, c’est-à-dire la sociologie, l’histoire et l’anthropologie, ont d’autres choses à dire sur le rêve. Il y a des couches de signification du rêve qui ne sont travaillées ni par les psychanalystes ni par les neuroscientifiques. Donc il faut que les sciences humaines s’approprient elles aussi les rêves comme objet légitime d’enquête.
Il s’agit non plus de tourner autour du rêve, mais d’entrer dans le rêve, dans la fabrique même du rêve, et de se risquer à une interprétation sociologique, anthropologique, historienne, du rêve. Ne pas seulement rester sur le pourtour en quelque sorte. Se demander : qu’est-ce qu’un rêve dit de la société, des groupes sociaux, des dominations sociales, des inégalités sociales, des propriétés sociales (et pas seulement familiales) du rêveur ? Qu’est-ce qu’un rêve dit de la culture même à laquelle il appartient, de ses valeurs, de ses mythes, de ses modes affectifs, de sa culture sexuelle par exemple ? Qu’est-ce qu’un rêve enfin dit de l’histoire passée, du sujet rêvant et de l’histoire collective qui l’a fait tel qu’il est ? Bref, comment l’histoire, la sociologie, l’anthropologie peuvent-elles s’emparer du rêve pour en faire un matériau scientifique à part entière pour les sciences sociales ?
Et là-dessus il n’y a pas grand chose. Il y a bien eu quelques expériences dans les années 1970, et quelques précurseurs mais, globalement, il n’y a pas grand chose. Ce n’est pas une Terra Incognita absolue des sciences humaines, mais quand même. Bernard Lahire a vraiment poussé très loin ce geste dans son livre, d’autant que c’est une enquête de vingt ans, à la fois théorique et empirique. Car un second tome va paraître, riche de nombreux témoignages de rêveurs. Et, de ce point de vue, notre numéro est une sorte d’excroissance, si l’on peut dire, de ce livre. Même si on trouve en son sein bien d’autres voix, des approches plurielles.
P.M. Oui, vous avez notamment diversifié les disciplines, c’est cela ?
H.M. Oui, mais aussi les espaces géographiques ; il y a une enquête sur les rêves de la jeunesse à Santiago du Chili, une enquête sur les rêves dans le monde kanak… Il y a aussi toute une étude dans la revue sur les songes autobiographiques au Moyen-Âge, une autre sur les rêves politiques au XIX° siècle, on approche aussi les rêves des colonisés dans les colonies britanniques… L’un des projets fondamentaux de la revue Sensibilités, c’est justement de sortir des carcans disciplinaires et de dire qu’au fond les sciences humaines partagent un même langage. À chaque fois, selon qu’il s’agit d’un historien ou d’un politiste, d’un anthropologue ou d’un psychologue, ce n’est qu’une manière particulière d’entrer dans l’interprétation des rêves, d’un fantasme, d’entrer dans l’étude de l’imaginaire. Ce sont là autant de portes d’entrée. Mais si on s’enferme dans sa discipline, au bout d’un moment, on finit par ne plus voir ce qu’on ne sait pas. On sature tellement le thème de recherche depuis notre propre et seule discipline qu’on ne voit pas tout ce qu’on laisse au pourtour, aux marges, dans l’angle-mort.
L’idée c’est donc de croiser ici toutes ces dimensions-là, mais en mettant en valeur chaque fois la dimension collective du rêve, en tentant de voir comment ce qu’il y a de plus social et collectif s’insinue jusque dans le plus individuel. Car a priori, on tend à penser le rêve comme ce qu’il y a de plus individuel dans l’individu, de plus subjectif. On a en quelque sorte l’impression que la société s’arrête aux portes du sommeil. Eh bien non…
P.M. Il y a le fantasme : vous pourrez m’enfermer, mais vous ne pourrez jamais prendre mes rêves.
H.M. Absolument, vous n’y aurez pas accès, c’est ma prison. Mais en fait, à l’intérieur de nous-même, le rêve est travaillé par des problématiques sociologiques en permanence. On emmène dans nos rêves nos conflits avec nos patrons, ou avec nos collègues, ainsi que des frustrations sociales par rapport à nos ambitions, professionnelles par exemple ; on emmène aussi des faits de génération, parce que les rêves diffèrent profondément d’une génération à l’autre, étant donné que ce ne sont pas les mêmes censures, les mêmes interdits, les mêmes tabous, etc.
Parce que le sociologique, ce n’est pas seulement l’appartenance à tel groupe social, classe laborieuse ou dirigeante, ce sont aussi les appartenances genrées et sexuelles : quelle sont mes préférences sexuelles et qu’est-ce qui s’en transporte, s’en dit dans mes rêves ? Ce qu’il faut au fond, c’est commencer par distinguer l’ensemble des appartenances du sujet en question (le rêveur). Pas seulement socioprofessionnelles, mais territoriales, religieuses, sexuelles, générationneles aussi, ou encore s’attarder sur la langue dans laquelle il rêve, parce qu’on ne rêve pas de la même façon dans toutes les langues, etc. Bref, il y a plein de choses à traquer dans le rêve pour les historiens, les anthropologues et les sociologues. Même si c’est tout sauf un sujet facile d’approche, tant tout ici est fugace, fragile, incertain.
Ce n’est pas une agression à l’égard de la psychanalyse que de dire tout cela. Nous sommes tous marqués par la psychanalyse et si nous sommes venus travailler sur le rêve, c’est bien parce qu’il y a eu une interpellation de la part de la psychanalyse à l’endroit des autres sciences humaines. En revanche, nous disons « Attention à ne pas répartir les tâches un peu trop facilement » : ce qui serait a priori du subjectif relèverait des sciences de la psyché, de la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, et puis après les neurosciences, tandis que ce qui a trait au collectif, au groupe, aux masses concernerait les sociologues, les politistes, les historiens, les économistes, etc. Mais en fait, ce que nous souhaitons rappeler, c’est que le collectif, il est là jusque dans le plus individuel, le plus intime. Et donc une des grandes ambitions du numéro, c’est bel et bien de sortir du divorce entre le psychologique et le sociologique, lequel coûte beaucoup aux sciences humaines. Il faut au contraire travailler selon nous à leur intersection et sortir une bonne fois de l’opposition factice entre individu et société.
P.M. Bon, on avait envie de parler du fond et de vous demander ce qu’on remarque, donc, en sociologie des rêves, mais puisque vous l’évoquez… C’est quand même pas évident, de faire travailler des gens ensemble, alors que déjà dans une seule discipline il y a des rivalités d’école qui peuvent être terribles. Est-ce que vous avez vraiment travaillé ensemble, c’est-à-dire relu les textes les uns des autres, fait des réunions de rédaction, discuté… C’est une école, aussi ? C’est nouveau, c’est quoi ?
H.M. C’est un peu tôt pour dire que c’est une école parce que la revue n’a que quatre ou cinq numéros. Mais les gens qu’on a rassemblés dans celui-ci ont l’habitude de traverser les disciplines, disons que ça ne leur fait pas peur de se parler entre anthropologues, psychanalystes, sociologues et j’en passe… Evidemment, parfois, il y a sans doute des incompréhensions, des malentendus qui peuvent persister, parce que d’une discipline à l’autre il existe des termes qui n’ont pas exactement les mêmes équivalents et d’autres qui n’ont pas tout à fait le même sens. Mais à mes yeux, une des choses dont j’ai horreur, c’est l’histoire qui se pratique pour elle-même, l’histoire qui ne s’intéresse qu’à elle-même, et qui ne va pas du tout se nourrir des autres sciences sociales, comme si on n’avait rien à apprendre des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des géographes…
L’histoire que nous pratiquons toutes et tous à l’intérieur de Sensibilités, c’est une histoire science sociale, au sens vraiment fort du terme. Une histoire qui n’a pas peur de se confronter au langage des autres disciplines. Parce que sinon qu’est-ce qui se passe à la fin ? Eh bien, les économistes s’occupent de l’homo economicus. Ils disent : « Ce qui prime c’est l’homme marchand, c’est l’homme qui échange, l’homme qui produit » ; et puis le psychiatre dira « Ben non, ce qui prime c’est le sujet avec ses conflits, ses tensions psychiques etc., c’est de lui qu’il faut partir », etc. En fait, il faut tout faire pour faire se rencontrer l’homo psychatricus, l’homo economicus, l’homo sociologicus, l’homo historicus, etc., sinon on s’aveugle tout simplement. On produit une science sociale mutilée, qui ne s’intéresse qu’à un arpent du territoire.
L’idée, c’est donc d’arriver à faire co-exister, cohabiter des chercheurs et des chercheuses qui viennent de toutes ces disciplines et pour l’instant, ça se fait sans conflits, avec beaucoup d’envie et beaucoup de curiosité… Tout le monde a besoin d’air, de sortir de sa spécialité, d’apprendre des autres chercheurs, même éloignés de nos centres d’intérêt, parce que l’université nous fait tendre sans cesse à davantage de spécialisation. Finalement, on a assez peu l’occasion de reprendre un peu de hauteur et de pouvoir discuter avec des représentants d’autres disciplines ou des spécialistes d’autres périodes historiques. Souvent, quand on est spécialiste du XIX° siècle, on se penchera peut-être un peu sur le XX°, mais on finit par ne plus lire ou presque de gens qui travaillent sur l’Antiquité ou le Moyen-Âge, faute de temps, d’habitude… Or c’est une perte terrible.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, dans le prochain numéro, on va s’efforcer de faire dialoguer les sciences humaines et les neurosciences autour des émotions. Ce qui n’est pas évident parce qu’il y a beaucoup de divorces et de conflits, les neurosciences envahissent absolument tout en ce moment (neurodroit, neuroéducation, neuromarketing, neuroéconomie…). Qui plus est, elles disposent de moyens financiers inouïs, alors que leurs fondements scientifiques peuvent parfois s’avérer très problématiques. Leur savoir est si technique et si spécialisé qu’ils doivent souvent se croire sur parole entre collègues… Mais, il n’empêche, il faut essayer de créer des ponts pour se comprendre, c’est un enjeu vital. Sauf à rester coincés dans la vieille opposition, ruineuse scientifiquement, entre nature et culture, entre l’inné et l’acquis, le biologique et le social.
P.M. Ouh là… C’est un gros conflit des deux côtés, là.
H.M. Oui je sais, mais il faut pourtant réussir à se parler… Et il y a moyen, parce que les neurosciences qui, à l’image de l’itinéraire d’un Antonio Damasio, avaient logiquement un programme biologisant, très naturalisant au départ, découvrent petit à petit la part culturelle et sociale de nos émotions et de nos comportements. Une notion, par exemple, comme celle de plasticité cérébrale – qui désigne la façon dont l’apprentissage et l’expérience vécue modifient la structure et l’activité du cerveau – est tout à fait compatible avec les sciences humaines.
En fait, on en revient très souvent au même problème : la question de la socialisation des enfants, notamment des « primes socialisations ». Et là, le biologique et le culturel, le non appris et l’appris, l’inné et l’acquis, se mêlent d’une façon souvent très surprenante. Même des pulsions et des émotions qui chez un nourrisson peuvent paraître instinctives, biologiques, innées, sont ensuite retravaillées, reformées, je ne sais pas comment dire, re-sculptées par l’éducation, par l’apprentissage, par la façon dont les parents, et le groupe familial dans son ensemble, éduquent leurs enfants en fonction de leur univers culturel propre. Et donc c’est ça qui est fascinant.
C’est d’ailleurs une discussion que quelqu’un comme Norbert Elias a pu engager avec Freud : la libido – la pulsion sexuelle – et la pulsion de mort – d’où provient l’agressivité – sont-elles invariables, demeurent-elles inchangées ? Ou est-ce qu’il y a une socialisation de la libido, une socialisation du désir ? Et un façonnement de la pulsion de mort par le refoulement de l’agressivité imposé du fait de l’impératif de vie en société, et le passage de la contrainte sociale à l’autocontrainte ? (Je penche, vous l’aurez compris, pour cette seconde hypothèse [Rires]). Là, il y a une discussion fascinante.
Au cœur du rêve
P.M. Alors, donc, quand on étudie sociologiquement les rêves, qu’est-ce qu’on découvre, finalement ?
H.M. Eh bien, déjà, on découvre des choses… Citons dans le numéro, par exemple, un article très précieux de Peter Burke, un très grand historien anglais, qui a remarqué la très forte pénétration du politique dans l’univers onirique des hommes et des femmes du XVII° siècle en Angleterre. Les deux grandes révolutions anglaises s’invitent au plus intime, dans les rêves des sujets britanniques. Et il constate ici, plein de bon sens, qu’on ne peut pas les interpréter en ramenant sans arrêt la figure du roi à la figure du père, ce qu’aurait tendance à faire l’approche psychanalystique. Le roi, dans les rêves, est parfois un roi. Bel et bien. Il faut prendre garde quand on est historien du rêve à ne pas opérer cette réduction familialiste constante et très freudienne, à ne pas puiser dans ce qu’on pense être un répertoire universel de symboles, mais rester attentif, au contraire, à la polysémie historique et culturelle des symboles.
Il n’est pas interdit de penser que tous les objets allongés ne se réduisent pas, en tous lieux et en tous temps, à des symboles uniquement phalliques. Comme vous savez, la grande thèse freudienne, c’est que le rêve est toujours l’expression déguisée de désirs sexuels refoulés. Sauf qu’il y a toujours chez lui la volonté de trouver, comme le regrettait Wittgenstein, une clé unique à même d’ouvrir le sens de tous les rêves et une tendance nette au pansexualisme, même s’il s’en défendait.
Je crois aussi qu’il faut prendre garde à la réduction familialiste permanente, c’est-à-dire au fait qu’en psychanalyse, finalement, toutes les figures sociales du rêve (les patrons, les collègues, les ouvriers, les rois, les clowns, que sais-je…) soient sans cesse rabattues vers le père, la mère, le frère, la sœur, etc. Bref, systématiquement ramenés vers la cellule familiale. Comme si dans un rêve ne pouvaient pas exister des figures sociales qui sont ce qu’elles sont, en quelque sorte. Le patron peut être un patron dans un rêve, sans être nécessairement un père ; un collègue n’est pas forcément à ramener à la figure du frère ou du beau-frère qu’on aime ou déteste ; une femme qu’on désire à la figure de la mère ou de la sœur, etc. Très souvent, il est vrai qu’on peut l’y ramener. Mais ce n’est pas toujours le cas. Ça, cela me paraît très important. Éviter le systématisme de ce genre d’explication. Et par là le forçage du sens.
L’exemple le plus clair, c’est sans doute le livre Rêver sous le III° Reich, de Charlotte Beradt, juive, communiste, une proche de Hannah Arendt sans être une intellectuelle à proprement parler. C’est pour résister au nazisme, dira-elle plus tard, qu’elle a collecté dans les années 1930 près de 300 rêves d’Allemands issus de toutes les couches sociales, allant des rêves de femmes de ménage jusqu’à ceux de grands patrons, dans un panel sociologique très riche. Il y a évidemment de grandes différences entre ces rêves, mais il y a aussi des constantes particulièrement intéressantes. Et ce que ces rêves signalent avant tout, c’est la lente disparition des frontières du public et du privé. La grande angoisse de ces rêveurs, ce sont par exemple les murs des maisons qui s’effondrent, l’impression d’être toujours sur écoute, la crainte d’être arrêtés pour des comportements non-conformistes, des choses comme ça. On voit bien comment la terreur hitlérienne, comment la situation politique de l’Allemagne nazie entre 1933 et 1939 finit par s’inviter aux creux des rêves, par s’inscrire jusque dans la matière onirique et par influer sur la structuration même du rêve chez ces individus angoissés, sinon terrorisés par ce qu’ils vivent sous le III° Reich. On voit donc ici là encore comment du politique peut s’insinuer jusqu’aux tréfonds psychiques des individus.
Voilà les premières choses que l’on remarque. Alors toute la difficulté, pour nous historiens, pour que ça soit véritablement signifiant, c’est qu’on ne peut pas seulement se baser sur un rêve, il faut essayer de trouver dans les archives ou dans nos sources des séries de rêves, séries qui vous renseignent sur l’existence de thèmes, de figures sociales, d’événements historiques redondants… Pour revenir à aujourd’hui, il serait peut-être intéressant par exemple de voir jusqu’où la problématique écologique aujourd’hui – du besoin de nature jusqu’aux angoisses de fin du monde – s’invite dans nos rêves beaucoup plus qu’autrefois. Je parierais volontiers là-dessus, alors que d’autres problématiques, celle du Diable sans aucun doute, ont largement disparu de nos rêves aujourd’hui.
Il existe donc des figures récurrentes dans nos rêves, qui sont comme des symptômes d’anxiétés typiques d’une époque… Et qui préparent peut-être aussi des « névroses d’époque », des troubles psychiques caractéristiques d’un temps ou d’un groupe culturel ou d’un groupe social. Pour être plus précis, il faudrait faire ici un détour par tout un champ d’étude qui s’appelle l’ethnopsychiatrie, héritière des travaux de Georges Devereux…
P.M. Pour laquelle ce ne sont pas les mêmes névroses selon les latitudes, on peut le dire comme ça ?
H.M. Voilà c’est ça, ni les mêmes noms, ni les mêmes formes, ni les mêmes soins. Le danger, ici, c’est l’universalisation abusive. C’est notamment de partir des nosologies de la psychiatrie telle qu’on la pratique et la connaît aujourd’hui en Occident, de partir de catégories médicales qu’on considèrerait universelles alors qu’elles ne le sont pas. L’exemple typique, c’est peut-être celui du syndrome post-traumatique. C’est une notion qui a été inventée après la guerre du Vietnam, laquelle a vu presque un tiers des soldats revenir traumatisés. Souvent dans l’après-coup d’ailleurs, pas tout de suite, mais 5-6 ans plus tard. Avec des symptômes spécifiques : repli sur soi, désocialisation, crises d’angoisses, cauchemars de reviviscence…
C’est alors qu’on a forgé cette notion de syndrome post-traumatique, qui renvoyait bien sûr à tout un savoir sur les névroses de guerre, mais qui n’existait pas avant comme tel, ou très différemment. Et maintenant cette notion, à force de s’étendre, est déjà très différente, puisqu’elle ne s’applique plus seulement aux anciens soldats, mais aussi à tous ceux qui ont fait face à des catastrophes d’ampleur, qu’elles soient naturelles (typhons, tsunamis, etc) ou humaines (type Fukushima ou 11 septembre). Bref, elle renvoie à des expériences traumatisantes liées à des situations de danger terrible pendant lesquelles des gens ont réellement craint pour leur vie. Mais si on applique ce concept étroit, psychiatrique et seulement psychiatrique, à l’ensemble des individus des sociétés du monde, on laisse échapper des spécificités culturelles et des névroses culturelles typiques qu’une catégorie si englobante ne permet plus de voir. Et on applique une méthode cathartique – la libération par la parole d’affects refoulés, réprimés – qui n’est pas valorisée partout dans le monde, parce que dans certaines cultures le partage public des émotions n’est pas valorisé, accepté, donc libérateur.
En somme, ça pose la question de savoir ce qui est vraiment universel : qu’est-ce qui est partagé par toutes les populations du monde et qu’est-ce qui, au contraire, varie toujours du fait de la diversité culturelle ?
Au cœur de l’humain
P.M. Et alors, qu’est-ce qui est universel ?
H.M.Est-ce qu’il y a des invariants ? Est-ce qu’il y a un universel ou des universaux qu’on retrouve d’une culture à l’autre ? Je crois pour ma part à l’historicité de presque tout et suis donc très attentif aux variations culturelles d’une société à l’autre. Mais ce qu’on me paraît retrouver dans toutes les cultures, c’est le contrôle pulsionnel. Dans toutes les cultures, on apprend aux enfants à maîtriser certains comportements, certains émotions, certaines pulsions spontanées. Ce contrôle pulsionnel existe et se pratique partout et à toutes les époques. En dehors de cela, et du seul fait qu’il existe, et non pas, et c’est très important, de la forme qu’il prend, de ce sur quoi il porte, tout varie partout, et dans de grandes proportions. Ce qui existe, et je serais très freudien ou nietzchéen plus encore, ce sont des pulsions, qu’on apprend à contrôler, qu’on s’efforce de contrôler. Soit en le refoulant, soit en les sublimant.
Au-delà de ça, tout varie sans cesse. Mais, dans toutes les cultures, il y a des comportements qui sont prohibés et d’autres qui sont prescrits, des attitudes, des pensées, des affects qui sont soit licites, acceptés, soit interdits, refoulés. Et ces lignes-là (qui finalement travaillent les rapports entre le conscient et l’inconscient), entre le prohibé et le prescrit, entre le licite et l’illicite, varient selon les sociétés, varient selon les générations, selon les milieux, etc. Ce qui va être l’objet d’une censure et d’un refoulement ailleurs ne l’est pas nécessairement ici, et inversement.
Par exemple, on trouve dans la revue un article d’un historien américain Erik Linstrum portant sur les rêves et les rêveurs dans les colonies britanniques du premier XXe siècle. Y sont examinées des grandes collectes de rêves faites durant les années 1920, en Océanie, en Afrique, aux Indes, par une équipe formée par l’anthropologue et fonctionnaire de l’empire britannique Charles Seligman, un passionné de psychanalyse, qui voulait mettre cette dernière au service d’une meilleure connaissance – et donc d’une meilleure administration – des sujets colonisés de l’Empire britannique. Il espérait aussi par là montrer l’universalité des thèses freudiennes – celle du complexe d’Oedipe notamment. Or ceux qui récupéraient les rêves des populations locales se sont vite rendus compte qu’on ne retrouvait pas forcément partout dans le développement de l’enfant à l’adulte les mêmes stades décrits par Freud – les stades anal, oral et génital -, ou alors qu’on ne retrouvait pas partout un semblable refoulement sexuel dans des sociétés qui étaient parfois beaucoup plus libres sexuellement et où l’éducation des jeunes était beaucoup plus permissive, bref, où on ne voyait pas les mêmes tensions sexuelles s’exprimer dans le contenu latent des rêves. Et ce, précisément parce qu’il n’y avait pas d’interdits aussi pesants, pas les même tabous entourant le domaine sexuel que dans l’Europe d’alors.
En revanche, ce qui est universel, c’est bien le fait que dans toutes les sociétés, on apprend aux enfants à maîtriser certaines pulsions, à les détourner ou à les canaliser. Après, quelles pulsions, jusqu’à quel degré, dans quelle direction on les détourne, via quelles sortes de sublimation… tout ça diffère profondément d’une société à l’autre. Mais il n’y a pas une société où on n’enseigne pas à maîtriser ses pulsions ou ses émotions, même si ensuite cet enseignement est toujours culturellement orienté.
P.M. D’accord, et ces différences alors ? Ces différences psychiques fortes, ces façons de ressentir et de dire ses émotions, quelles sont-elles, dans l’histoire de notre propre culture occidentale ?
H.M. Il y a eu par exemple beaucoup de travaux dans les années 1920, 30 et 40 sur la vie affective et mentale des sociétés d’autrefois. Par exemple, le très beau livre de Johan Huizinga L’Automne du Moyen-Âge, auquel fait écho un autre grand livre de Marc Bloch, La Société féodale, touts deux mettant en exergue le fait que l’émotivité médiévale était beaucoup plus forte que la nôtre, beaucoup plus expansive, parce que la vie elle-même était beaucoup moins sécurisée, sécurisante, beaucoup plus fragile et menacée qu’aujourd’hui en Europe. Les sautes d’humeur étaient nettement plus brutales, on passait plus rapidement de grandes joies à des grandes tristesses et de façon beaucoup moins contrôlée, l’émotivité était plus paroxystique dans un sens ou dans un autre. Et la rationalisation des comportements, la répression des émotions spontanées, le réfrènement des pulsions, c’est quelque chose qui historiquement est allé croissant au fil des siècles comme l’ont montré un Lucien Febvre et, plus encore, Norbert Elias, qui a donné un nom à cette évolution : le processus de civilisation.
L’acmé de ce processus de régulation pulsionnelle et émotionelle, c’est sans nul doute la société victorienne, le comportement des élites anglaises du XIX° siècle. Des moeurs particulièrement corsetées, des conduites surveillées, de la gêne, de la pudeur, des émotions particulièrement retenues. L’Anglais de la fin du XIX° siècle ne veut plus pleurer… Darwin, le grand savant britannique, en était d’ailleurs très fier. Pour lui, la grandeur de l’homme anglais tenait notamment dans sa capacité à ne plus pleurer, tellement il avait appris à ne pas pleurer, à être fort et raisonné. Contenir, réprimer ses émotions est devenu un impératif social, un moyen de distinction. Ce qui a pu déboucher sur des conflits psychiques particulièrement aigus. Depuis le début du XX° siècle, et surtout depuis les années 1960-70, on note une moindre surveillance de nos émotions, une communication autour de nos émotions beaucoup plus admise qu’autrefois. L’expression de ses émotions est aujourd’hui beaucoup plus valorisée et souhaitée qu’auparavant. De là, des profils psychiques très différents, d’autres structurations de la personnalité. C’est ce que des sociologues hollandais comme Cas Wouters, un ancien étudiant de Norbert Elias, appelle « l’informalisation des conduites ». Nos moeurs sont plus relâchées, nos conduites moins formelles, nos pudeurs moindres qu’à la fin du siècle dernier, en matière sexuelle notamment.
Mais pour en revenir à l’émotivité médiévale, il ne s’agit pas du tout de dire que les hommes du Moyen-Âge étaient des « barbares » ou des « sauvages » qui ne savaient pas se maîtriser. Il s’agit simplement de rappeler que les conditions de vie étaient telles, en termes de mortalité et de mortalité infantile notamment, d’épidémies, de guerres, de risques de pillages et ainsi de suite, que, au vu de cet environnement social et politique instable, les régimes émotionnels différaient, les cultures affectives étaient autres. On ne pouvait pas avoir les mêmes attitudes à l’égard de la vie, à l’égard de la mort. De sorte que l’historien se doit de retrouver ces autres univers mentaux et affectifs en refusant à tout prix l’anachronisme psychologique.
Autre exemple, mis au jour par un chercheur anglais, qui travaille à nos côtés pour la revue, même s’il ne figure pas au sommaire de ce numéro : Thomas Dodman. Sa thèse portait sur un phénomène assez inouï, qu’on appelait la nostalgie. Au début du XIX° siècle, dans les années 1840, chez les soldats français qui partaient faire la conquête de l’Algérie, un mal s’est répandu à très grande vitesse qu’on appelait justement « la nostalgie ». C’était une sorte de mal du pays, particulièrement puissant, qui touchait avant tout les soldats venant de régions enclavées, des Alpes, du Massif Central, des Pyrénées, et qui mouraient, littéralement, du mal du pays une fois en Algérie. C’était même contagieux, d’ailleurs, car au bout d’un moment les officiers ont fini par séparer les individus atteints de ce mal pour ne pas qu’ils le fassent passer au reste de la troupe. Et à la fin, ce qu’on appelait, médicalement donc, la nostalgie, a fait autant de morts que le typhus et la malaria chez les soldats qui partaient combattre en Algérie.
P.M. Quelle est l’explication de l’historien ?
H.M. Ça s’explique sans doute parce que ces gens-là vivaient généralement dans un rayon de vingt kilomètres autour de chez eux : nous sommes au début du XIX° siècle, avant la grande expansion des chemins de fer, avant l’exode rural massif. Or, tout d’un coup, cet arrachement culturel et territorial à ces petites communautés chaleureuses de l’entre-soi a pu générer chez ces hommes des affections psychosomatiques, des troubles importants, des souffrances d’abord psychiques mais qui avaient très rapidement des répercutions physiologiques graves, puisque, je le répète, ces maux débouchaient sur une mort à proprement parler. Or, de ce que je sais, ce type d’atteinte ne semble pas exister chez les soldats contemporains qui partent en Afghanistan ou au Pakistan. Peut-être parce qu’il y a une plus grande habitude du voyage, de l’éloignement, peut-être parce que l’attachement au pays natal ou à la région est beaucoup moins fort qu’autrefois, parce que les soldats actuels sont mieux préparés à l’expérience de ces guerres lointaines… La vraie raison, si tant est qu’il y en ait une seule, n’est pas connaissable. C’est comme un trouble d’époque, disparu aujourd’hui : désormais le mot « nostalgie » a pris une toute autre acception. Mais à l’époque, c’était une catégorie médicale, qui désignait ce mal-là précisément.
P.M. Comment mouraient-ils ?
H.M. Ils dépérissaient. Au début on aurait dit une sorte de dépression, une perte de goût pour l’existence, ce qu’on appellerait, nous, une déprime mais, petit à petit, ces soldats ne s’alimentaient plus, s’affaiblissaient, s’isolaient, le corps s’atrophiait et finissait par tellement s’atténuer que mort s’ensuivait.
P.M. Cela rappelle l’expérience de certains réfugiés cambodgiens, qui mouraient littéralement de cauchemars (et dont l’histoire a d’ailleurs inspiré le film Les Griffes de la Nuit).
H.M. Je ne connais pas cette histoire, mais cela fait fortement penser à un article du numéro signé par Anouche Kunth, une chercheuse au CNRS qui avait fait sa thèse sur l’exil des Arméniens du Cacause consécutif au génocide de 1915. Elle a suivi de nombreuses destinées dans l’exil, puis les traces laissées par ce traumatisme collectif au sein familles dans l’après-coup. Ici, dans ce article, elle nous parle des « sommeils blancs », un phénomène qu’on retrouve également chez certains rescapés de la Shoah. Ce qu’elle appelle ces sommeils blancs, ce sont des sommeils sans rêve, sans fond. Des individus qui ont fait face à des peurs tellements puissantes, à des terreurs tellement intenses qu’il pouvait leur arriver de s’endormir d’un sommeil qu’on pourrait dire sans fond, en tout cas sans rêves, comme s’ils voulaient/devaient échapper à la réalité, à une réalité trop effroyable pour être soutenue, regardée en face. Des sommeils si profonds que ces individus ont pu se réveiller parfois jusqu’à deux voire trois jours plus tard, sans avoir la moindre image, le moindre mot, la moindre explication à mettre sur ce qui s’est passé dans l’intervalle : il n’y a rien.
Ce qui suggère un mécanisme de défense. Quand la frayeur, quand l’effroi, quand des affects engagés par l’événement sont trop paroxystiques, l’individu coupe littéralement via ce sommeil tout rapport aux autres et au reste du monde… Comme si les affects pouvaient être pétrifiés par cette faculté, comme si elle pouvait protéger le psychisme d’un éclatement littéral… On est là vraiment aux abords de la folie, à la jointure du rêve et de la folie. Enfin, du non-rêve et de la folie, plutôt.
P.M. À titre personnel, qu’est-ce qui vous a le plus frappé en travaillant le numéro ?
H.M. Outre cet article, la rencontre de deux ethnologues réalisateurs, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, qui ont mis la main sur des heures de bande émanant d’un somniloque (quelqu’un qui parle en rêvant) du nom de Dion McGregor. Il a été enregistré à son insu dans les années 1970 par son colocataire sept années durant, la nuit, quand il parlait. Ce qui est formidable là-dedans, c’est que… On dit souvent que les rêves n’existent pas ; que ce qui existe, ce sont seulement des récits de rêve. Des rêves restitués dans l’après-coup. Un rêve, c’est toujours, finalement, ce qu’on en sait au petit matin, au réveil, et là, ce qui est hallucinant dans cette matière si singulière, c’est qu’on dispose d’un accès direct au rêve en train de se faire, en train de se dire. Sans censure, sans contrôle du langage. C’est une parole un peu délirante, souvent émaillée d’onomatopées, de phrases qui ne sont pas terminées…
Mais ce n’est pas la confusion absolue. On peut y reconnaître des récits véritables, des récits structurés, avec une authentique narration en direct, si l’on peut dire. On comprend bel et bien une histoire. Et l’on voit affleurer des rêves qui sont tout sauf politiquement corrects. Une sorte de mélange de Lautréamont, de Sade et de Bataille, je dirais. Il y a des rêves de crimes, des rêves d’orgies, une ville de nains à louer, des mutilations d’ongles de femmes, bref toute une perversité du rêve assez fascinante et inquiétante. L’inconscient, en principe, on l’attrape toujours par des manifestations conscientes, par des comportements quotidiens (rougissements, embarras physique…), par des ratés du langage, comme les lapsus ou, au contraire, via les mots d’esprit. Bref, tout ce que Freud a désigné dans Psychopathologie de la vie quotidienne… Là, l’inconscient affleure et il est proprement terrifiant. Du moins celui de Dion Mc Gregor, lequel, de ce que je comprends de sa trajectoire biographique, était un individu assez instable affectivement, à la fois fasciné et horrifié par les femmes, qui rêvait d’une réussite qu’il n’a jamais eue, d’où des frustrations et des haines tenaces, mêlées toutefois à des moments d’empathie réels…
P.M. Ça, il y en a d’autres…
H.M. Oui, c’est vrai !
P.M. Mais c’était pathologique, ça l’empêchait de vivre ?
H.M. Non, ça ne l’empêchait pas de vivre. D’ailleurs, quand son colocataire a fini par lui dévoiler les bandes, il ne s’est pas reconnu au début. Il pensait qu’on lui avait fait prendre du LSD à son insu, puis il a eu une phrase assez amusante : « C’est à peu près comme si j’étais devenu célèbre en ayant fait pipi au lit. » Car, en effet, il va en effet devenir célèbre à son insu ; il y aura des reportages, des albums faits avec ces bandes de rêves, entre autres.
P.M. C’est vrai qu’au fond, on ne sait jamais ce dont on se souvient de nos rêves.
H.M. Et plus encore : on ne sait jamais tout à fait ce qu’on leur fait quand on les raconte. Ou quand on les écrit. Rien que les mettre en forme c’est déjà les rendre plus cohérents, établir des liens aussi qui n’étaient pas forcément là. Par là, on les re-fabrique. On les tamise sans doute, via de nouvelles censures qui s’invitent dans la réécriture des rêves… On n’a donc quasiment jamais un accès plein et direct au rêve. D’où l’extrême intérêt de cette matière repérée par Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor. Ça a d’ailleurs été très compliqué pour ce qui concerne la traduction, parce que la transcription, bien sûr, était en anglais. On a beaucoup hésité avant de les passer en français, ce qu’on a fait finalement pour les rendre plus accessibles, tout en y adjoignant la version anglaise, mais ce qui posait beaucoup de questions : ponctuation ou pas ponctuation ? Et si ponctuation, laquelle, quand et comment ? On trouve aussi bien sûr des mots quasiment incompréhensibles… Comment fait-on alors ? C’était passionnant. C’est Verena Paravel qui a fait ce travail, au plus près des textes.
P.M. Vous revenez en détail sur cette problématique dans la revue. Mais vous affrontez aussi de front une autre question, essentielle, et qui répond à notre premier réflexe quand on aborde votre travail… On se dit : « Mais… ils n’ont pas de matière ! Peut-être à partir de la psychanalyse, à la rigueur de l’époque romantique, mais avant, comment trouver des récits de rêve ? »
H.M. Eh bien si, on a beaucoup de choses, étonnamment. Le médiéviste Jean-Claude Schmitt et la latiniste Gisèle Besson, par exemple, ont publié l’an passé un livre qui s’appelle Rêver de soi, les songes autobiographiques au Moyen-Âge, une véritable somme où ils livrent des récits de rêves autobiographiques s’étalant du VIII° jusqu’au XV° siècle. Des récits de rêve au Moyen-Âge, de fait, il y en a énormément. À l’époque, on ne gardait pas son rêve pour soi ; il appartenait aux autres. On s’attendait à ce que les autres s’en emparent, pour les interpréter.
J’en veux pour preuve ce que raconte Alban Bensa dans la revue. Cet ethnologue spécialiste du monde kanak explique que, lorsqu’il est arrivé la première fois en Nouvelle-Calédonie pour y effectuer son terrain, il n’osait d’abord pas interroger les habitants sur leurs rêves, parce qu’il trouvait cela trop intime et voulait apprendre à bien les connaître, individuellement, avant d’aborder des sujets qui lui paraissaient aussi secrets… Mais il se rendit bientôt compte que, dans le monde kanak, le rêve n’appartient pas du tout, comme chez nous, au registre de l’intime. C’est même tout l’inverse. C’est quelque chose qu’on partage collectivement, qui concerne toute la communauté. Le rêve comme lieu secret, comme refuge de notre subjectivité, c’est très occidental et contemporain, en réalité.
On trouve aussi beaucoup de matière dans ce qu’on appelle « les clefs des songes » : ce sont des traités d’interprétation des rêves, qui remontent à l’Antiquité et au célèbre manuel d’onirocritique d’Artémidor de Daldis, dont le travail a fasciné pendant des générations, jusqu’à Freud lui-même. Bref, on a des matériaux, vraiment.
Ça ira mieux demain
P.M. Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Vous vous dites, « Il faut qu’on les collecte, pour les historiens et sociologues du futur ? »
H.M. Bien sûr, si vous me demandez à moi, je vous dirais qu’on n’en fait pas assez ! Heureusement que la psychanalyse a encore un peu de poids, même si elle est en train de décliner du fait de l’émergence des neurosciences et de leur poids toujours croissant dans l’espace public. Car on voit encore des gens qui écrivent leurs rêves, dans les cafés, le matin, précisément parce qu’ils sont en analyse. Hélas, le développement d’autres formes de psychothérapie fait que cette pratique commence un peu à disparaître. Enfin, sans doute pas partout. Car je crois qu’aux États-Unis il existe des banques de rêves proprement gigantesques. Après, il y a collecte et collecte. Il faut être très précautionneux dans nos manières de collecter les rêves. Comme l’expliquent notamment le sociologue Laurent Jeanpierre et les psychanalystes Estaban Radiszcz et Pablo Reyes dans leur enquête sur les rêves des adolescents chiliens contemporains, il faut accumuler des informations précises sur les propriétés sociales des rêveurs, sur les contextes même du rêve, sur les associations faites par les rêveurs, etc. Dans l’absolu, il faudrait aussi savoir ce que le rêveur a vécu la veille voire l’avant-veille… Parce que sans les associations du rêveur, c’est souvent très compliqué de donner du sens au rêve.
Bernard Lahire, quant à lui, après le premier tome théorique de L’interprétation sociologique des rêves dont on a parlé plus haut, prépare un second volume à partir d’une matière empirique qu’il a lui-même suscitée, collectée minutieusement au cours de longs entretiens avec des rêveurs. Bref, il faut ici beaucoup de méthode et de patience. Surtout si on veut croiser les regards disciplinaires comme ici, à la croisée des approches sociologique et psychanalytique du rêve.
P.M. Une dernière question : quelle est la place de la religion dans tout cela ? Parce que l’importance de la religion (ou des religions) dans une société donnée à travers le temps, et l’évolution des croyances, c’est quelque chose de très facile à cartographier du point de vue historique. Et donc ce doit être relativement facile de voir si cela correspond à ce qu’on trouve de religieux, de lié à la religion, dans les rêves, à travers les âges et les sociétés.
H.M. Pour ce que je sais de l’histoire occidentale, depuis le XVIII° siècle, on constate une progressive mais très nette déchristianisation, sinon désacralisation des contenus du rêve au fil du temps. Qui rêve encore aujourd’hui du Jugement dernier ? Qui se rêve au Paradis ? Se cauchemarde aux Enfers ? De moins en moins de monde, c’est certain. Dans nos rêves inquiétants, angoissés, le diable, les sorcières, les inquisiteurs ne s’invitent presque plus. Au XIX° siècle déjà, l’imaginaire des rêveurs se peuplait différemment.
Vous pouvez regarder à ce sujet le travail de Dominique Kalifa et son beau livre Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire. On y voit comment, au XIX° et au XX° siècle, se substitue progressivement un autre imaginaire à celui de l’Enfer : un imaginaire à la fois inquiétant et fascinant, celui des bas-fonds sociaux, où se mêlent des miséreux, des voleurs, des prostituées, de petits délinquants ou de grands criminels à un moment où, avec l’exode rural, les villes s’entourent de faubourgs, d’une population instable, pauvre, transgressive des normes sociales, jugée « déviante » par des élites bourgeoise très inquiètes d’être ainsi entourées. D’où le développement d’un sorte de fantasme collectif que l’expression « Les Bas-fonds » cristallise. Et il est certain que ces figures fantasmées se sont invitées de plus en plus dans les rêves des contemporains. On peut constater aussi que les rêves liés à la nature, aux événements de la nature (orages, tempêtes, arc-en-ciel…), ne sont plus lus sous l’angle du présage divin, que la nature elle-même s’est peu à peu désacralisée, qu’on y a de moins en moins vu des signes religieux et des présages divins. Elle s’est en quelque sorte laïcisée, prosaïsée pourrait-on dire. La déchristiannisation des esprits et la déchristiannisation des rêves sont des processus qu’on peut suivre en historien. Ce serait d’ailleurs très intéressant de faire des collectes de rêves aujourd’hui dans les monastères et de voir à quoi rêvent les moines ou dans les paroisses auprès des prêtres… Mais c’est sans doute compliqué.
P.M. Donc des gens ont cauchemardé qu’ils erraient dans les enfers… Ça devait être terrifiant !
HM. Bien sûr, chez les sujets chrétiens… On trouve dans Rêver de soi, le livre de Jean-Claude Schmitt, des récits de rêves pétris d’anxiétés, de craintes, d’effroi, à l’idée d’errer éternellement aux Enfers. J’imagine que La Divine comédie de Dante ou les peintures de Jérôme Bosch disent quelque chose des figures de l’imaginaire collectif qui imprégnaient les rêves des acteurs de leur temps. Ajoutons aussi que, dans toutes les sociétés traditionnelles, on constate une authentique continuité entre les mythes et les rêves. Ce sont des vases communicants. Entre les mythes, les religions et les rêves, il y a des portes et ça communique, très clairement. Mais le problème demeure celui-ci, posé par le grand historien italien Carlo Ginzburg après Claude Levi-Strauss : » Est-ce nous qui pensons les mythes, ou sommes-nous pensés par les mythes ? »
« La Société des Rêves » le numéro 4 de la revue Sensibilités, est paru aux éditions Anamosa.